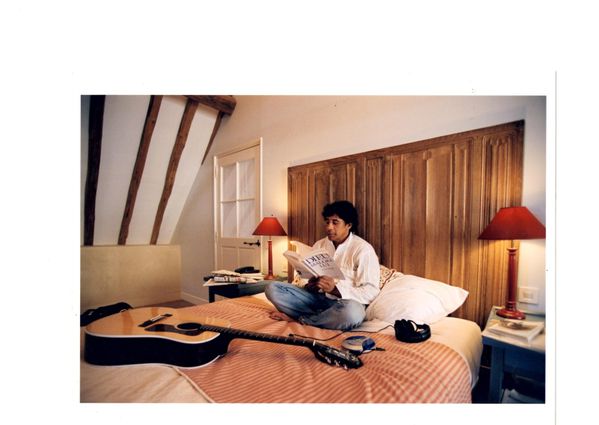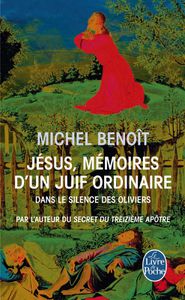Au IV° siècle, l’Empire romain était totalement imprégné par le culte solaire de Mithra. Il s’en est fallu de peu que Julien l’apostat, formé au christianisme dans son enfance, n’impose un mithraïsme réformé, avec « médiateur » et trinité solaire, qui aurait pris la place du christianisme alors en formation.
En retour, ce culte a marqué de son influence le christianisme, puisque Jésus est souvent représenté depuis avec les attributs solaires, la liturgie ancienne l’appelle sol oriens (soleil levant), la date du 25 décembre sera choisie comme dies natalis (jour de naissance) du Christ, les églises sont toutes orientées vers l’Est…
Finalement, c’est le christianisme qui l’a emporté, peut-être grâce à son insistance sur la souffrance humaine – négligée par le mithraïsme. Un « Dieu souffrant » sédu isant plus facilement des foules souffrantes qu’un dieu solaire triomphant des ténèbres…
L’évolution du christianisme peut se schématiser ainsi :
– Un Rabbi juif est divinisé pour des raisons essentiellement « politiques », et au contact des religions à mystère de l’Empire. L’influence gnostique est forte (gnose grecque et juive).
– Pendant deux siècles, christianisme primitif et religions orientales cheminent côte à côte, en rivalité de plus en plus vi olente. Irénée est le premier à organiser la confrontation.
– En 313, Constantin publie un Décret de tolérance qui instaure une compétition politique (avantages économiques, fiscaux, exemptions..) entre christianisme et religions anciennes
– Les chrétiens, libérés par cet édit, se déchirent entre eux : sous une apparence dogmatique, ce sont surtout des querelles de pouvoir. Les sectes chrétiennes pullulent, l’Arianisme en tête qui refuse la divinité de Jésus. En 325, un concile partiel (Nicée) fixe la doctrine de la tendance dure (divin isa tion de Jésus), mais les opposants ne l’acceptent pas. L’ Empire se déchire entre un Occident catholique et un Orient Arien.
– Julien se rend compte que l’Empire romain va disparaître s’il perd son ossature religieuse et culturelle. Il tente, vers 360, une restauration du mithraïsme.
– La mort rapide de Julien fait avorter cette tentative. Comme prévu, l’Empire s’effondre.
– Sur ses restes, l’Église chrétienne s’établit par un double mouvement :
- Persécution des religions anciennes, prise du pouvoir (privilèges politiques et sociaux), puis élimination des rivaux religieux (sauf arianisme). A la fin du IV° siècle, l’Église apparaît seule debout dans un champ de ruines.
- Consolidation du dogme de l’Incarnation par celui de la Trinité (Chalcédoine, 451) : établissement d’une forteresse dogmatique à laquelle collaborent des esprits à la fois brillants et fanatiques d’Orient et d’Occident.
– Sur ce socle dogmatique se construit lentement l’édifice sacramentel : entre le 8° et le 10° siècle, le couple sacerdoce-épiscopat est bétonné, le célibat des prêtres défini. Autour du 10° siècle, fixation du sacrement de mariage, tissu conjonctif de la société chrétienne.
– Autour du 13° siècle, fixation de l’eucharistie : on conceptualise la transformation de la substance du pain en substance du ressuscité, grâce au recours à la philosophie aristotélicienne qu’on vient juste de redécouvrir.
– Au 11° siècle, schisme orient-occident pour raisons purement politiques. Mais il faudra attendre 1871 pour que la dernière conséquence en soit tirée : la définition du dogme de l’infaillibilité papale. Peu après, échec des conversations entre Newman et les anglicans, où l’on évoque la reconnaissance des ordinations anglicanes – qui aurait réunie à Rome l’Église d’Angleterre et ses colonies, notamment américaines.
– Au tournant du 20° siècle, 1° crise moderniste : l’Église, qui a encore une certaine vitalité intellectuelle (renouveau thomiste des années 20 à 40), réagit. Elle achève l’édifice sacramentel en définissant le « moment » de la transsubstantiation : les par ole s de la consécration et non pas l’épiclèse qui la précède – rejetant ainsi une main tendue de l’Orient, pour qui c’est l’épiclèse qui est le centre de la prière eucharistique.
– 2° crise moderniste : l’après-guerre. La structure hiérarchique de l’Église est mise en cause par le mouvement théologique (Congar, de Lubac, Rahner…) et social (les prêtres-ouvriers, les nouvelles fondation religieuses)
– Vatican II : ne condamne pas, mais se contente d’entrouvrir quelques portes : ministères, rapprochement avec les chrétiens « séparés »… Bien évidemment, on ne touche pas aux fondements dogmatiques. C’est un Concile « pastoral » : par ce terme qui définit son (absence d’) ambition, l’Église avoue qu’elle n’a plus les moyens de bâtir, ou de re-bâtir, un édifice doctrinal ou idéologique d’envergure.
– Le long règne de Jean-Paul II fige durablement cette pétrification de l’Église : toute recherche est condamnée (théologiens sud-américains, Drewerman), toute ouverture refermée (Gaillot), l’Église se crispe sur la morale sexuelle. Les avancées idéologiques, religieuses (au sens large) et spirituelles se font désormais en-dehors de l’Église : altermondialisme, condition de la femme, écologie, recherches sur l’identité de Jésus, méditation, retour des religions « orientales » (hindouisme, bouddhisme…).
Bref, on est revenu à une situation analogue au IV° siècle, à une différence près : l’Église n’est plus l’ad olescent fougueux d’alors, en croissance irrésistible. C’est un vieillard fatigué, ankylosé par les énormes calcifications idéologiques héritées de ses réactions ponctuelles à des situations nées en des époques successives du passé.
Mais qui, une fois pétrifiées, interdisent tout mouvement.
La chape dogmatique, faite d’éléments superposés au cours des siècles, devient le couvercle d’un cercueil qui enterre l’Église. Elle n’est plus capable que de s’agripper à cette chape, reliquat à la fois fastueux et pesant d’un passé révolu.
Prenons du recul : on voit une grande période de construction dogmatique, entre le 2° et le 4° siècle. Puis une continuation sur la lancée, qui devient par la suite une calcification.
La différence entre les conciles du IV° siècle et Vatican II est parlante : l’Église du XX° siècle a perdu tout élan constructeur, elle n’est plus qu’un conservatoire de son passé. Sa marge d’adaptation à la vie qui continue est très restreinte (quelques bricolages sans envergure) et surtout sans ambition. Au cours du 20° siècle, elle montre clairement qu’elle a perdu tout contact avec la marche de l’humanité, sur le plan religieux et humain.
Conservatisme et perte de contact allant évidemment de pair.
La question se pose : peut-on espérer un retour, dans l’Église, à sa créativité des quatre premiers siècles ? Et quand on connaît l’intrication des ambitions politiques et des objectifs religieux de cette époque fondatrice, est-ce souhaitable ?
Ou bien le besoin de vie religieuse de l’humanité va-t-il désormais s’exprimer hors l’Église, ce qui semble être le cas ?
Et alors : quel rôle notre génération (qui a encore connu une certaine Église) peut-elle, doit-elle jouer, pour que l’effacement de cette structure ne s’accompagne pas de l’effacement de Jésus ?
M. B., 10 janvier 2007