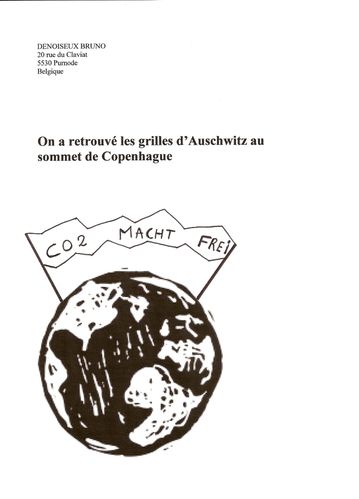I. L’analyse d’un expert financier
Didier Bouvignies (1) voit dans la chute du mur de Berlin la cause initiale de la crise financière que nous connaissons.
Jusque là, deux systèmes coexistaient sur la planète : le capitalisme, basé sur la création de richesse, et le socialo-communisme soucieux de la distribution de ces richesses.
L’effondrement du système communiste a laissé le capitalisme seul, en position de monopole idéologique absolu.
Depuis la crise de 1929, les USA et l’Occident balançaient entre deux doctrines : celle du libéral Adam Smith, et celle de Keynes qui prônait une certaine régulation de l’économie . Avec Reagan inspiré par Milton Friedman, l’ultralibéralisme l’a emporté à partir des années 1980 :
« Le marché, et lui seul, doit réguler ses propres excès. Aucune autorité extérieure ne doit le faire à sa place ».
On connaît le résultat :
1- Endettement considérable des ménages américains, favorisé par la fin de l’inflation et une baisse générale des taux d’intérêts.
2- La mondialisation, qui a fait de la Chine le principal fournisseur de biens manufacturés de l’Occident. Avec un yuan dévalué de 60%, la Chine est devenue le banquier des USA.
3- La déconnexion entre revenus et actifs financiers : en 1976, 10% de la population captait seulement 35% des revenus, contre 50 % aujourd’hui ! Et les 10 % les moins bien payés ont vu leur pouvoir d’achat rétrograder au niveau de 1970.
La pauvreté a augmenté dans les pays « riches ».
4- La complexité de l’ingénierie financière, qui a mis sur le marché des produits « toxiques » impossible à détecter.
Le résultat ? Un capitalisme total, aussi appelé capitalisme sauvage, sans autre contrôle que l’appât du profit immédiat.
Quelles perspectives d’avenir ?
D. Bouvignies rappelle que comme les historiens, les économistes savent prédire le passé, jamais le futur.
Il semble qu’aucun homme ou système politique ne soit en mesure aujourd’hui de réguler une machinerie aussi complexe que l’économie et la finance mondialisées. L’avenir est abandonné entre les mains d’êtres humains devenus aveugles – depuis que leurs autorités intellectuelles, morales ou politiques, ont reconnu leur incapacité à le conduire ou même à le contrôler.
Et encore moins à l’inspirer : l’ambition prophétique a disparu, l’activité humaine de création et de distribution de richesses vogue comme un paquebot sans gouvernail.
La cause de la crise économique et financière ? C’est l’être humain, et lui seul.
C’est une crise de l’Homme et de ses valeurs.
II. La situation au siècle de Jésus
Au I° siècle, l’immense Empire romain offrait un peu l’équivalent de notre mondialisation, toutes les richesses produites finissaient par converger vers Rome. Une petite minorité de (très) riches citoyens romains ou affranchis spéculaient librement sur les terres, ou le commerce du grain, de l’huile, du vin, des métaux.
En face, une importante population d’esclaves dont certains profitaient de la richesse de leurs maîtres, d’autres n’étant que des bêtes de somme.
Pas de rébellion des premiers (qui vivaient souvent mieux que du temps de leur liberté), les seconds étaient crucifiés à la moindre tentative de révolte : le capitalisme romain disposait d’une main-d’œuvre gratuite, docile et inépuisable.
Entre les riches et les esclaves, pas de classe moyenne mais une population fluctuante de citoyens assistés, nourris et payés pour laisser faire.
C’était donc un capitalisme aussi sauvage que le nôtre, dominé par le profit des possédants. L’État n’avait ni prise sur la vie économique, ni la moindre ambition régulatrice.
La femme ? Elle était uniquement épouse et mère.
Absente de la vie sociale, économique et politique, on ne s’adressait pas à elle, et elle n’avait pas droit à la parole. La réflexion philosophique était réservée aux hommes, et à quelques exceptions près les cultes religieux étaient masculins.
L’enfant ? Il n’existait pas – tant qu’il n’avait pas revêtu la toge prétexte, vers 12 ans.
Alors, il devenait adulescens (être humain en devenir) jusqu’à la toge virile, vers 16-17 ans. Il ne commençait à exister qu’avec sa première barbe – quand il pouvait porter les armes.
III. Jésus et le capitalisme sauvage
Rome accordait une large autonomie aux religions de ses colonies, mais se réservait la politique, l’économie et la finance. Les impôts, lourds, étaient régulièrement perçus sous la menace militaire.
Des roitelets locaux (comme Hérode Antipas) n’avaient aucune autorité et collaboraient avec la puissance occupante : en échange de quoi ils pouvaient mener une vie luxueuse.
Il est surprenant de constater que Jésus semble s’être accommodé du capitalisme sauvage ambiant, certaines de ses paraboles en font presque l’éloge. Aucune critique du « contrat social » de son temps. Il n’a jamais rien dit de l’esclavage, ni du chômage qu’il côtoyait pourtant : pas un mot pour les laissés pour compte du système.
C’est que dans la culture juive, on les appelait indistinctement les « pauvres », et la Loi de Moïse (seule de son espèce à l’époque) faisait de l’aumône une obligation. Mais l’État théocratique juif – ou ce qui en tenait lieu – ne se préoccupait pas plus que l’État romain de corriger les inégalités sociales : seul le particulier était tenu à l’aumône. Sous forme d’impôts supplémentaires, les autorités religieuses ou civiles juives aggravaient la situation au lieu de tenter de la soulager.
Jésus a pratiqué et loué l’aumône individuelle, mais il n’a pas dénoncé les rapines du Sanhédrin ou d’Hérode. Contrairement à ses compatriotes Zélotes, il a accepté l’impôt et recommandé de le payer.
On peut voir dans sa consigne « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » la charte de notre laïcité – et en cela, Jésus était totalement novateur dans sa société théocratique. Mais notre sensibilité aurait attendu quelque chose sur la complicité entre l’État et les spéculateurs ou collaborateurs d’une part, l’assiette et l’usage de l’impôt de l’autre.
Membre à part entière de la société de son temps, il est pourtant le seul à avoir eu une vision prophétique de l’avenir.
Résigné devant l’incapacité du politique à réguler le capitalisme sauvage, apparemment conscient de sa propre impuissance à changer la société, il s’est concentré sur la transformation de l’humain.
Une transformation radicale, mais mise en œuvre de façon individuelle.
Sa conception du prochain est révolutionnaire en Israël. Le prochain pour lui, c’est tout être humain, sans distinction de race, de religion, de classe ou d’impureté rituelle.
Il a été le premier non-violent de l’histoire : non seulement tu ne haïras pas ton ennemi, mais tu accepteras de te laisser frapper, dépouiller ou embrigader par le méchant, sans protester.
Les femmes ? Non seulement il s’adresse à elles (qu’elles soient étrangères, impures ou criminelles), mais il les écoute attentivement, dialogue avec elles, se penche sur leurs maux.
Les enfants ? Non seulement ils existent pour lui – il les accueille et les protège de ses disciples – mais il fait de ceux qui leur ressemblent l’exemple et le modèle des candidats à la société dont il rêve.
Jésus n’a pas proposé un nouveau modèle économico-social, il a voulu créer un nouveau type d’Homme.
N’est-il pas frappant qu’un analyste financier parvienne à la conclusion que les crises, avec leurs conséquences de plus en plus dramatiques et imprévisibles, naissent de l’absence d’un projet humain et prophétique analogue à celui du juif Jésus ?
Ni Marx, ni Keynes ni Friedman n’ont osé proposer pareille révolution.
Elle est à la portée de chaque individu.
M.B., 7 décembre 2009
(1) Expert financier de stature internationale, il a donné le 5 décembre dernier une conférence brillante et accessible à L’Université Pour Tous. Ce qui suit n’est en aucun cas un compte-rendu de cette conférence, mais son écho dans mon domaine de recherche particulier.