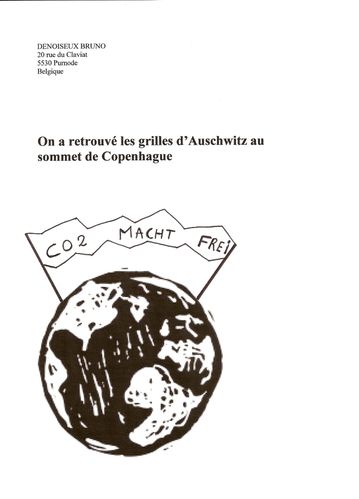C’est à Jérusalem, peu de temps après la mort de Jésus, qu’a été essayé en grandeur nature le premier ‘’programme de gauche’’ : l’égalité absolue entre tous.
On ne peut pas comprendre cet épisode si on ignore l’existence en Israël à cette époque d’un puissant courant messianiste : tous les Juifs attendaient le relèvement de leur pays, grâce à la venue d’un Messie miraculeux. Chez les premiers chrétiens, cette attente avait pris une coloration particulière : Jésus allait revenir sans tarder, le ‘’Grand Soir’’ était imminent.
C’était la lutte finale, elle avait déjà commencé.
I. Jésus et le ‘’système’’
Jésus lui-même a clairement et explicitement refusé le titre de ‘’Messie’’ que ses disciples voulaient lui attribuer. Il n’a jamais eu de programme social.
Pourtant, dans la Palestine comme partout ailleurs au I° siècle, régnait un capitalisme sauvage. Or Jésus ne s’est pas attaqué à ce système, il n’a jamais dit qu’il fallait »prendre aux riches pour donner aux pauvres », n’a jamais condamné les riches parce qu’ils étaient riches.
Au contraire, il était entouré d’amis fortunés qui le subventionnaient généreusement. Selon Matthieu, il a fait l’éloge de serviteurs qui spéculaient pour le compte de leur maître – lequel, quand il estime que l’un d’eux a mal géré son capital, le fait jeter… en enfer (25,14-30).
Ailleurs, il a loué un patron qui profitait du taux de chômage élevé pour embaucher des intermittents quand ça l’arrangeait, et les payait sans tenir compte des conventions collectives en usage. Ses ouvriers sous contrat venaient-ils protester ? Il leur répondait que « tel était son bon plaisir » et qu’il « disposait de ses biens comme il lui plaisait. » (20, 1-15).
Matthieu écrivait en milieu juif, tandis que Luc vivait à Antioche. Est-ce l’influence des mœurs romaines ? Son Jésus semble trouver normal qu’un maître donne « un grand nombre de coups » à ses serviteurs désobéissants, et « seulement un petit nombre » aux fautifs par erreur (12, 47-48). Ailleurs, il raconte l’histoire d’un homme riche qui avait un intendant malhonnête. Dénoncé, que fait l’intendant ? Tant qu’il dispose du livre de comptes, il continue de tromper son maître en annulant dans la colonne de gauche les dettes de ses créanciers. Le Jésus de Luc fait l’éloge de cet intendant doublement malhonnête : « Et moi, je vous dis : faites-vous des amis avec l’argent trompeur. » (1)
On ne lit dans les Évangiles aucune de ces condamnations radicales du système, qu’on attendrait aujourd’hui d’un prophète de monde meilleur, plus juste, plus égalitaire.
Ce que Jésus a enseigné, c’est la nécessité de l’aumône.
La richesse est fragile dit-il, « les mites font tout disparaître et les voleurs dérobent » : par l’aumône faite aux pauvres, on « s’amasse des trésors dans le ciel » (Mt 6,19-21).
Ce capitalisme spirituel était une règle ancienne, traditionnelle, du judaïsme : en la faisant sienne Jésus n’a rien innové, sauf dans la radicalité de cette aumône. Ce que la Loi juive ne demandait nullement, il conseille de « vendre tout ce qu’on a, et de le distribuer aux pauvres » (Mt 19,16-30). Ce n’était là qu’une illustration concrète de son choix de vie particulier, inhabituel en Israël, et qu’il donnait en exemple à ceux qui voudraient l’imiter : ne pas chercher à faire advenir le Grand Soir social, ne pas dénigrer la richesse des riches, mais tout quitter pour vivre à la grâce de Dieu.
Il n’a pas cherché à ‘’changer le système’’ : c’est lui-même qu’il a changé, en choisissant de vivre à sa marge.
S’il a apporté un souffle d’air frais dans ce monde, c’est en lui tournant le dos.
Un prophète prêche d’abord par son choix de vie et de valeurs. Parvenue jusqu’à nous, l’onde de choc qu’il a provoquée vient de sa désintégration sociale personnelle, voulue, assumée.
II. L’Église primitive et le ‘’Grand Soir’’
Quand le même Luc écrit les Actes des apôtres, il décrit une Église en formation qui est profondément traversée par une idéologie messianiste dont témoignent les textes contemporains retrouvés à Qumrân. Une utopie totalitaire, qui a eu des conséquences ravageuses (cliquez) : on allait créer un monde nouveau (cliquez) , un ‘’non-système’’ où tout serait beau, tout serait parfait.
L’égalité de tous, dans le bonheur et la prospérité générale.
Et les apôtres, à l’origine de ce programme gauchiste ? Ils avaient fermé boutique, quitté leur misérable petit gagne-pain pour suivre Jésus. Le Lider charismatique mort, finie pour eux l’hospitalité généreuse et quotidienne des riches admirateurs, finies les tables servies. Ils n’ont eu aucune envie de reprendre leur activité de pêcheurs gagnepetits : mais comment assurer leur subsistance et celle de leurs familles, sans retourner trimer jour et nuit sur les eaux décevantes du lac de Galilée?
La réponse se lit dans les Actes : ils vont obtenir des croyants qu’ils mettent tout en commun (2, 44).
S’agissait-il de ‘’prendre l’argent des riches pour le donner aux pauvres’’, premier slogan gauchiste ? Pas exactement. « Nul ne considérait comme sa propriété l’un quelconque de ses biens… Nul parmi eux n’était [plus] indigent : ceux qui possédaient des terrains, des maisons [ou des biens] les vendaient, apportaient l’argent et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins » (4, 32-34).
Ce n’était pas ‘’à chacun selon son travail’’, mais ‘’à chacun selon ses besoins’’ – autre slogan gauchiste, d’ailleurs minoritaire.
Bien évidemment, les besoins des apôtres passaient en premier, on les voit voyager avec leurs femmes, être partout reçus… Ce fut donc la naissance d’un clergé socialement oisif, entretenu par les dons de travailleurs ayant choisi librement d’alimenter ce système-là, dans l’espoir de sortir de l’autre.
Du côté des riches, nivellement social vers le bas, par abandon spontané (2) de leurs avoirs. Du côté des pauvres, enrichissement inespéré, immédiat, sans travail ni effort.
Les riches ne l’étaient plus, les indigents cessaient de l’être : pour eux, ce fut un rêve éveillé, Noël de janvier à décembre, sept jours sur sept.
Hélas, Noël ne dura pas. L’Église de Jérusalem, initiatrice et expérimentatrice du nouveau système, sombra rapidement dans la faillite.
D’autant plus – manque de chance – qu’au moment même où l’utopie gauchiste (distribuer) prenait le pouvoir à Jérusalem, une crise éclata (3) : la réalité économique (produire) ne suivant plus, on se mit à manquer de tout. La situation se détériora au point qu’il fallut organiser une collecte dans le reste du ‘’monde’’, pour venir en catastrophe à l’aide des gauchistes de Jérusalem.
Il n’y avait alors ni FMI, ni BCE et le SPQR (4) avait d’autres soucis que sa lointaine province de Judée. On se tourna donc vers les toutes jeunes Églises d’Asie Mineure.
Elles venaient d’être fondées par un certain Paul de Tarse, qui leur avait donné dès le départ une consigne formelle : travailler, pour ne pas vivre d’assistanat (1Th 2, 9). « Dans la peine et la fatigue, de nuit comme de jour, travailler pour n’être à charge de personne » (2Th 3, 8).
Paul lui-même organisa le programme d’aide aux « saints » de Jérusalem : « Le lundi, chacun mettra de côté chez lui ce qu’il aura réussi à épargner, afin que vous n’attendiez pas mon arrivée pour rassembler les dons… Quand j’arriverai », j’irai en personne les porter là-bas (1Co 16, 2-4).
Est-il mal intentionné de penser que Paul, alors en conflit ouvert avec les apôtres de Jérusalem, songeait également à marquer des points sur ses rivaux, en arrivant chez eux les poches pleines d’argent frais à distribuer ?
L’Église a retenu la leçon, et écarté définitivement tout relent gauchiste de son programme. Elle a étendu à la chrétienté l’impôt versé au clergé (qui s’est longtemps appelé ‘’la dîme’’). Et quand une portion de l’Amérique Latine s’est montrée prête à basculer dans la Théologie de la Libération (directement inspirée du texte des Actes) elle l’a d’abord condamnée, puis étouffée.
L’utopie gauchiste, elle, n’est pas morte. Elle a resurgi brièvement au XIV° siècle, chez les Dolciniens d’Italie si bien décrits par Umberto Eco dans son Nom de la Rose. A été combattue par les Jacobins français, qui inscrivirent le droit à la propriété individuelle dans la constitution de la 1° République. S’est réveillée au XIX° siècle, d’abord en France, puis en Allemagne, avant de s’épanouir en Russie, en Chine, à Cuba… avec les succès que l’on sait.
Les peuples oublient les leçons de l’Histoire. Et l’historien, de par son métier, n’est pas porté à l’optimisme.
M.B., 22 avril 2012
(1) Luc 16,1-9. Parole d’évangile que reprendra à son compte F. Mitterrand, quand, en 1981, il dénoncera à la télévision le « mauvais argent. »
(2) Je passe pudiquement sous silence l’incident d’Ananie et Saphire (Actes 4) qui montre qu’à Jérusalem la spontanéité n’était pas toujours au rendez-vous. Ceux qui souhaitent connaître les détails de cet épisode crapuleux liront avec profit Jésus et ses héritiers, mensonges et vérités .
(3) Une succession de mauvaises récoltes dans le pourtour du Bassin méditerranéen.
(4) Senatus Populusque Romanum : le gouvernement central de l’Empire.