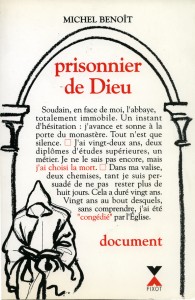La crise de l’Occident, dont nous sommes les témoins inquiets, est un sujet qui nous touche profondément, parce que nous sentons qu’elle concerne notre civilisation. La plupart des analystes la décrivent sous son aspect économique, démographique, environnemental, politique, moral ou social. Je voudrais porter sur cette crise un autre regard, afin d’en identifier – si c’est possible – la racine profonde. Ce regard, personnel, se situe dans le cadre de recherches historiques et sociologiques qui font l’objet d’un vaste débat.
I. Définitions
Et d’abord, il faut définir 4 termes que nous emploierons.
1) Civilisation
J’emprunte ma définition à l’école américaine de sociologie : une civilisation, c’est une identité culturelle, associée par chaque individu à une partie de l’humanité à laquelle il peut s’identifier. Cette partie de l’humanité est un groupe plus étendu que la tribu, la région ou la nation.
Mais j’emploierai aussi une image plus familière : je dirais qu’une civilisation, c’est un peu comme un grand et vieil arbre. Nous n’apercevons que les hautes branches, touffues, dans lesquelles nous avons fait notre nid. J’essayerai d’identifier aujourd’hui l’une des racines, devenue quasi invisible pour nous, mais à partir desquelles notre arbre occidental a acquis sa stature ancestrale.
2) Référent
L’identification des peuples à une civilisation s’effectue à travers ce que la linguistique appelle des référents : un référent, c’est un outil verbal qui désigne un élément du réel. Déjà, Thomas d’Aquin expliquait que le concept (notre « référent ») pointe vers une chose (une res) qui a sa réalité propre, en-dehors du langage. La question cruciale, nous le verrons, est alors de savoir comment fonctionne l’adéquation entre le référent, et la chose qu’il désigne.
Ce réel, désigné par les mots à travers lesquels s’exprime une civilisation, il peut être du domaine des faits (par ex., la prise de la Bastille), mais aussi de l’imaginaire. C’est particulièrement vrai du fait religieux, dans lequel les sociologues identifient l’un des référents fondateurs de toute civilisation.
3) Crise
Restons-en provisoirement à notre image familière : il y a crise quand les racines d’une civilisation sont devenues tellement lointaines, que les hautes branches ne peuvent plus y puiser leur sève. Le vent, la pluie, les tempêtes soufflent : l’arbre résiste mal, parce qu’il est mal enraciné.
Il a trop oublié. Il ne sait plus ce qu’il fut, il ne sait plus ce qu’il est.
4) Occident
Sa définition a d’abord été géographique : c’était la civilisation née de la Grèce, et qui se répandit autour du bassin méditerranéen. Son épicentre, situé à Rome, se déplace ensuite vers Constantinople. Mais jusqu’à la fin du VII° siècle, ce que nous appelons aujourd’hui le Proche et le Moyen Orient font encore partie intégrante de l’Occident et de sa civilisation, à laquelle ils apporteront des contributions inestimables.
Quand, en 1453, Constantinople tombe sous la coupe de l’Empire Ottoman, l’Occident se voit privé de toute sa partie orientale.
Rapidement (1620) il va compenser cette perte en déplaçant sa frontière vers l’Ouest : mais la conquête de l’Amérique par les européens s’est faite dans des conditions très particulières, qui expliquent que la civilisation américaine s’éloigne de plus en plus de sa matrice européenne. C’est pourquoi je vous parlerai surtout ici de l’Occident européen.
Et déjà, nous dégageons un résultat important : à cause de son Histoire, la civilisation occidentale n’est plus une entité géographique, mais une réalité conceptuelle, référentielle.
II. Construction du référent fondateur de l’Occident
Tout commence avec Jules César. En 63 avant J.C., très jeune mais déjà animé d’une ambition dévorante, il reçoit la magistrature suprême. Il devient Souverain Pontife de la religion d’État. Quelques années plus tard, il impose à Rome sa dictature : pour la première fois en Occident, les pouvoirs civil et militaire se trouvent réunis, avec le pouvoir religieux, dans la main du même homme. Cette conjonction des deux pouvoirs en un seul s’imposera à tout l’Occident, et jouera un rôle essentiel dans la naissance de ses référents culturels.
Au début de notre ère, Rome traverse une crise d’identité. L’un des deux piliers du pouvoir, la religion de l’État romain, est agonisante. Et l’Empire est envahi par des religions venues d’Orient – dont la mieux connue et sans doute la plus répandue est le culte solaire de Mithra. Ces religions sont anciennes, mais une nouvelle venue va faire une entrée fracassante : le christianisme.
Cette religion est légalisée par Constantin en 313. L’un de ses successeurs, Julien dit l’Apostat, tentera en vain une restauration du culte romain : le premier, il avait compris l’importance des référents culturels dans la survie d’un Empire. Nous savons qu’il était convaincu que la civilisation romaine disparaîtrait, si sa religion ancestrale ne retrouvait pas, dans l’État, sa place traditionnelle.
Et c’est bien ce qui s’est produit. Fragilisé par la perte de son identité religieuse, l’Empire va disparaître, dégluti par les barbares. Ce fait historique illustre mon propos : c’est quand leur panthéon, et leur culte traditionnel, ont disparu de la vie des romains, qu’ils ont cessé d’être un grand peuple porteur de son identité culturelle.
Voilà donc quel sera mon fil conducteur : La perte des référents qui l’ont constituée, provoque la fin d’une civilisation donnée. La crise d’une civilisation, c’est la crise de ses référents.
Cette crise aurait pu être fatale à l’Occident, si le christianisme ne s’était pas immédiatement substitué à la civilisation romaine naufragée, en lui apportant ses référents propres. Mais l’accouchement d’une nouvelle identité culturelle en Occident va se faire dans la douleur, à cause de l’élaboration difficile du dogme, et donc de l’identité chrétienne.
En effet, les chrétiens à peine nés se déchirent autour d’un point central : l’identité de Jésus de Nazareth. L’image de cet homme va être progressivement transformée, au point que vers l’an 100, le rabbi juif itinérant est devenu Dieu.
Une question va dés lors se poser, lancinante : si Jésus est Dieu, est-il toujours homme ? Et s’il reste homme, est-il également Dieu ? Comment ces deux existentiaux, inconciliables, peuvent-ils se trouver fusionnés dans le même individu ?
La réponse à cette question va susciter des affrontements, dont la violence nous étonne aujourd’hui. Je m’y arrête parce que les Empereurs – qui avaient réussi l’union, dans leur personne, du politique et du divin – ont pris une part active dans les luttes qui déchirent les chrétiens entre eux. C’est qu’ils étaient conscients qu’une nouvelle civilisation était en train de naître, et qu’elle avait besoin de référents indiscutables, et indiscutés.
Le dogme de l’incarnation, la définition de la divinité du Christ jusque dans ses plus petits détails, va donc être la question centrale autour de laquelle se construira, lentement, douloureusement, le nouveau référent, le socle identitaire de la civilisation occidentale.
Je vous passe les détails. Rappelons seulement que l’arianisme, né à la fin du II° siècle, et qui s’oppose à la transformation totale de Jésus en Dieu, a bien failli l’emporter.
En 392, l’Empereur Théodose décrète le christianisme religion d’État. Parfois par la force, le pouvoir impérial va contraindre la Grande Église à adopter une formulation acceptable de la divinité du Christ. Avec le concile de Chalcédoine, en 451, le christianisme disposera d’un référent suffisant pour s’imposer dans l’Empire. Mais ce n’est qu’en 681, à la fin du VII° siècle, que l’Église surmonte toutes les hérésies, et que les dernières conséquences de la divinisation du Christ sont tirées au clair[1].
S’ensuivent trois siècles qui sont les plus sombres de l’histoire occidentale : difficiles tentatives de reconstitution de l’Empire, invasions musulmanes, invasions multiples… L’Église est le seul îlot stable, émergeant de cette mer démontée. Solidement campée sur le dogme de l’incarnation, désormais indiscuté, L’Europe trouve dans l’Église la force de sa survie, le référent de son identité et de son unité face à ses adversaires.
La période qui suit (VII° / VIII° siècle) apparaît comme une période charnière.
On voit en effet Alcuin, théologien de Charlemagne, élaborer la notion de monarque de droit divin. Je remarque que cette doctrine politique n’a pu prendre naissance qu’à partir du moment où la divinisation de Jésus était acquise en Occident. De même que le Christ est l’image terrestre du Dieu invisible, de même l’Empereur devient l’expression visible, sur terre, de la volonté divine – et ceci, jusqu’à la Révolution française.
A ce moment charnière de l’Histoire, l’Occident a donc trouvé dans la divinité du Christ la justification du pouvoir. Mais le dogme de l’incarnation, parce qu’il est devenu un référent compris et accepté par tous, marque de son emprise l’éthos – c’est-à-dire l’horizon éthique, culturel, social, esthétique – de la civilisation occidentale. Jusque dans les moindres détails leur vie quotidienne, les hommes et les femmes d’Occident seront formatés par les ramifications de ce dogme fondateur.
Dire que l’Occident s’est construit autour du christianisme, c’est une banalité. Je cherche à aller plus loin, et vous proposerais d’identifier, dans la lente et chaotique transformation de l’homme-Jésus en Dieu, la racine profonde, la matrice originelle de la civilisation occidentale.
III. La fin d’une civilisation
J’ai parlé de moment-charnière : en effet, c’est à la fin du VII° siècle, quand le dogme de l’incarnation n’est plus discuté en Occident, quand ce référent-là est devenu le socle de tous les autres, qu’un vigoureux mouvement d’origine arabe lance au monde un défi : une nouvelle religion, qui rejette explicitement l’incarnation de Dieu en Jésus, qui affirme l’unicité de Dieu, et accuse l’Occident d’avoir fabriqué, à côté du Dieu-très-Grand, un deuxième Dieu, incarné.
Au chercheur, Le Coran apparaît d’inspiration entièrement judéo-chrétienne. Il répond à l’éternelle question, qui a si longtemps agitée la chrétienté : qui est Jésus ? Et puisqu’il refuse sa divinité, quelles sont les voies d’accès au divin ? En rejetant ce qu’il appelle « la magie chrétienne », le Coran crée le référent d’une nouvelle civilisation, qui attire à lui le quart de l’humanité.
L’islam coranique est donc la seule réforme radicale du christianisme qui ait réussi, là où tous les hérétiques de la Grande Église avaient successivement échoué. Il l’a fait, et continue de le faire, en s’opposant à une chrétienté considérée par lui comme infidèle à l’unicité de Dieu, c’est-à-dire païenne.
Mais revenons à l’Occident. Solidement campé sur une identité qui trouve sa source dans le dogme de l’incarnation défendu par l’Église, il continue sa route. Et quand il étend sur la planète son modèle de civilisation, le christianisme triomphe avec lui.
Vont alors se produire trois secousses majeures. La première, la Réforme protestante, va entamer l’unité européenne cimentée autour de Rome. Mais Luther et Calvin n’ont pas remis en cause le dogme de l’incarnation, ils n’ont pas touché à l’identité occidentale. Avec le recul de l’histoire, le moment le plus révolutionnaire de la Réforme apparaît comme celui où Luther traduit la Bible en langue allemande. A son insu peut-être, en mettant le texte sacré à la portée de tous, il a permis à l’Occident d’échapper au piège redoutable du fondamentalisme : nous allons y revenir.
La seconde secousse, c’est le mouvement des Lumières, le triomphe de la raison sur la foi considérée comme irrationnelle. Mais sa diffusion touche surtout les élites : au XIX° siècle, l’empreinte des Églises chrétiennes est encore très forte sur l’Occident. Grâce à la colonisation de la planète par les occidentaux, elles deviennent des puissances mondiales.
C’est dans ce XIX° siècle qu’on voit apparaître les premiers signes d’un déclin du christianisme, déjà en germe dans les secousses précédentes. Troisième secousse, la laïcité instaure la séparation des Églises et des États. Mais les référents des nouvelles nations européennes restent chrétiens. Les Églises, qui ont officiellement perdu leur emprise sur les sociétés, transfusent en elles l’essentiel de leurs valeurs. Le code Napoléon, qui servira de modèle aux législations européennes, puise dans saint Paul une bonne partie de sa morale individuelle et sociale, ainsi que l’inspiration de ses lois.
Cependant le déclin des Églises est là, inexorable. Il sera un temps masqué par l’expansion missionnaire du XIX° siècle, puis par la montée des fascismes au début du XX°, pour se transformer très rapidement en effondrement.
Ce sont des sociologues américains qui se sont penchés sur la notion d’effondrement des civilisations. Arnold Toynbee[2], Joseph Tainter[3], Samuel Huntington puis Jared Diamond[4] : tous reconnaissent, comme Christopher Dawson[5], que « les grandes religions sont les fondements des grandes civilisations ». Mais dans leurs travaux, aucun ne donne au référent religieux la place centrale qui lui revient. Ils l’analysent de l’extérieur, à coup de statistiques, et finissent par attribuer l’effondrement des civilisations à des causes économiques, sociétales ou environnementales. Dans la lecture que je vous propose, au contraire, j’envisage la naissance et la mort d’une civilisation en suivant son marqueur principal, l’évolution du référent religieux. Je complète l’analyse trop factuelle des américains en intégrant les résultats de l’école française de sociologie, qui a étudié de près le déclin du catholicisme en France, et sa signification dans le déclin de notre civilisation.
Il n’est pas possible de résumer ici ses conclusions. Je préfère rappeler à ceux de ma génération des faits qu’ils ont vécus : revenons, par la mémoire, aux années d’après-guerre.
Jusqu’aux années précédant 1958, date symbolique[6], l’Église en tant qu’institution était partout présente. Souvenez-vous : partis politiques Xns, syndicats Xns, éducation Xenne, mouvements de jeunes Xns, organismes caritatifs Xns (devenus ONG), présence hospitalière et même carcérale…. Mais aussi littérature (Claudel, Bernanos, Mauriac…), philosophie (Maritain, Gabriel Marcel), poésie (Péguy, Marie Noël), musique (Honegger, Poulenc), peinture (Rouault, Cocteau), architecture (Le Corbusier) : en un demi siècle, le catholicisme en tant que référence a disparu en France du champ de la créativité.
Certains affirment que ce qu’il a perdu en Occident, il l’a retrouvé dans les pays du Tiers-monde, notamment Afrique et Brésil. Mais le dynamisme catholique de ces pays n’est qu’apparent. D’abord, il est encore souvent lié à la promotion sociale. Ensuite, on y voit monter en puissance l’extraordinaire foisonnement de sectes très diverses, et du fondamentalisme évangélique américain : ils sont en train d’y supplanter les Églises.
Ceci, c’est l’aspect spectaculaire du phénomène. Mais reprenons notre fil conducteur :
1) Comme on pouvait s’y attendre, l’effondrement a été précédé par une perte de signification des référents, qui avaient permis la montée en puissance de la civilisation occidentale. Prenons un tout petit exemple, la Toussaint : ce jour férié a perdu toute signification, au point d’être un temps concurrencé par Halloween. On pourrait analyser ainsi tous les grands référents chrétiens : les concepts restent en vigueur dans la société, mais ils ne renvoient plus à leur res, à leur réalité d’origine (cf. enquête La Vie, Noël 2006).
2) Allons plus profond : à partir du XIX° siècle, des chercheurs (protestants, puis catholiques) commencent à étudier la Bible avec un outil nouveau, la méthode historico-critique. Utilisant la linguistique, l’archéologie, l’épigraphie, l’Histoire comparée, ils situent le texte sacré dans ses époques et ses lieux d’origine, dans sa culture de formation. Ils cherchent à dégager les faits, et les différents messages, de leurs contingences historiques. De plus en plus, ils vont se libérer, dans leur lecture, des lunettes contraignantes du dogme. Ils redécouvrent ainsi la personne, et la personnalité de Jésus, la façon dont il a été transformé en Dieu, et les motifs de cette transformation.
La vieille question de l’identité du Christ est donc remise sur le tapis : et ce n’est plus de façon polémique, comme par le passé, mais par l’étude sereine et objective. Le principal référent de la civilisation occidentale n’est plus remis en cause de l’extérieur, par ses ennemis, mais de l’intérieur, et par ses spécialistes les plus talentueux.
De même que j’ai identifié, dans la divinisation de Jésus, le référent fondateur de la civilisation occidentale, je vous propose d’identifier, dans cet effacement ou cette remise en cause de l’ensemble de ses référents religieux – et du principal d’entre eux, le dogme de l’incarnation – l’une des racines profondes de la crise de l’Occident. Cet effondrement, il a été en quelque sorte officialisé au moment de la discussion d’une constitution européenne : pour la première fois depuis ses origines, l’Europe a officiellement refusé en 2004 de reconnaître dans le christianisme la racine d’un vieil arbre, dont le rêve d’un nouveau surgeon bute sur l’absence de valeurs fédératrices.
Samuel Huntington écrit que « Les civilisations sont mortelles, mais elles ont la vie dure ». La crise de l’Occident, je ne la vois pas d’abord dans le « Choc des Civilisations » qu’il décrit. Mais bien plutôt dans la disparition des référents d’une civilisation – la nôtre.
Face à ce désastre, nous voyons naître un double péril, que j’ai appelé le choc des fondamentalismes.
IV. Le choc des fondamentalismes
I. Le premier, nous le connaissons, il est présent à tous les esprits : c’est le fondamentalisme de l’islam radical.
J’emploie le terme d’islam avec réserve, car il recouvre une civilisation multiforme, extrêmement riche, et dont je ne suis pas un spécialiste. En revanche, j’ai pris le temps d’étudier le Coran : c’est de ce texte que je vous parlerai ici, et de lui seul.
Pour ceux qui s’en réclament, le Coran est en quelque sorte la parole matérialisée du Dieu qui se révèle grammaticalement, syntaxiquement, dans la construction verbale du texte arabe. Il n’y a donc plus ici de distance entre le référent et la réalité qu’il désigne : le texte fait référence à lui-même, il trouve en lui-même sa justification, et l’explication de ses obscurités.
Considéré comme l’expression matérielle de la pensée divine, le Coran est donc intouchable : Dieu ne peut pas être soumis au feu de la critique historique. L’origine divine du Coran est un dogme absolu, et les islamistes radicaux lancent des arrêts de mort contre tous ceux qui prétendent l’interpréter en-dehors d’une tradition, alimentée par le Coran lui-même. L’exemple le plus célèbre est celui de la Fatwa lancée contre Salman Rushdie.
Nous tenons ici la première définition du fondamentalisme : un texte, devenu l’équivalent d’une présence réelle de Dieu, est pris à la lettre. Sans tenir compte ni des circonstances culturelles, géographiques, religieuses et politiques de son écriture, ni de la façon dont il peut être reçu longtemps après, et en fonction de contextes socio-politiques nouveaux.
Ajoutons que l’islam est habité par une ambition messianique, qui l’a toujours fait rêver à la conquête du monde : nous allons revenir sur ce point, crucial.
II. L’autre péril, nous l’évaluons moins bien, parce qu’il est plus récent : je crois pouvoir l’identifier dans le fondamentalisme évangélique. En fait, le mot fundamentalism a été employé pour la première fois aux Etats-Unis, à Niagara Lake en 1895, par un groupe de responsables d’Églises protestantes américaines. Ils s’étaient réunis pour s’opposer aux progrès de l’exégèse historico-critique, dont je vous parlais il y a un instant. En 1910, une espèce de Credo du fondamentalisme a été défini en cinq points : le premier affirme la divinité du Christ, le cinquième proclame que c’est Dieu lui-même qui parle dans la Bible, laquelle doit être prise à la lettre et ne peut jamais se tromper.
Il ne vous échappe pas que ce fondamentalisme évangélique ressemble à s’y méprendre au fondamentalisme islamique : même sacralisation d’un texte, même refus de le soumettre à l’épreuve de la critique historique. Et même affirmation sans nuances du référent fondateur – l’unicité de Dieu pour les uns, la divinité du Christ pour les autres.
Dès son origine, le fondamentalisme américain est lui aussi fortement messianique.
A partir des années 1970, ce mouvement qu’on appelle « évangélique » ou « néo-conservateur » a repris vigueur aux Etats-Unis, de façon foudroyante. Il dispose là-bas d’une audience populaire considérable, et de l’appui affiché du gouvernement actuel. Vous devez savoir que grâce à ses moyens financiers, il est en train d’envahir la planète.
En effet, le messianisme natif des fundamentalists a pris une tournure particulière. Pour eux, le Messie tant attendu est enfin arrivé : c’est la morale, le mode de vie et de consommation, la démocratie et le capitalisme à l’américaine. C’est l’Amérique sûre de ses valeurs, et prête à les imposer à toute la planète, fut-ce par la force.
L’effondrement de la civilisation occidentale semble avoir laissé, face à face, deux fondamentalismes, tous deux messianiques, identiques dans leur utilisation d’un texte devenu sacré, et qui s’opposent par leurs référents.
Ce qui me paraît rendre la situation extrêmement dangereuse, c’est :
1- La force et la solidité des référents religieux respectifs. Chacun connaît exactement sa vérité propre, chacun peut d’autant mieux s’identifier à elle qu’elle est simplifiée à l’extrême, sans nuances.
2- L’énergie motrice de chacun des messianismes, l’un tourné vers La Mecque, l’autre tourné vers le rêve américain. Deux référents devenus plus imaginaires que réels, mais qui fonctionnent parfaitement, et donnent à ces fondamentalismes leur coloration totalitaire.
J’aurais voulu terminer sur une note d’optimisme : mais les historiens sont rarement optimistes, confrontés qu’ils sont aux soubresauts de l’Histoire et aux souffrances de l’humanité au cours des siècles. Ils analysent, ils ne prédisent pas.
Pour l’instant, la nostalgie d’un grand arbre occidental, ayant retrouvé des racines, devra nous tenir lieu d’espérance.
M.B., mai 2007.
(Texte de la conférence donnée à Tours le 28/04/07