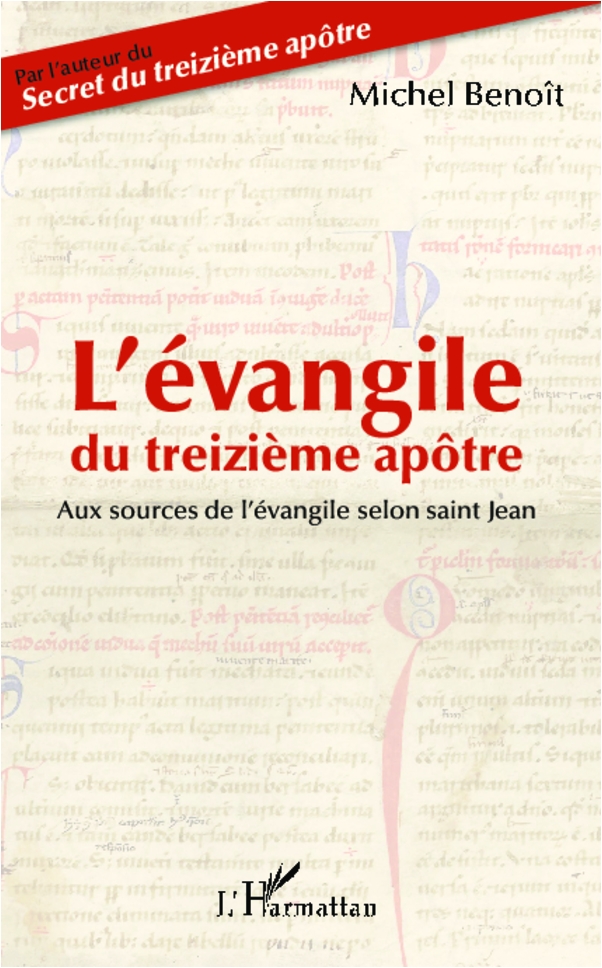Fin avril va paraître un livre sur le Coran, et celui-là n’est pas comme les autres.
En 140 pages, j’ai voulu synthétiser un siècle de recherche indépendante de façon claire, simple, compréhensible.
Voulant en avoir le cœur net, vous achetez une des nombreuses traductions françaises du Coran. Par curiosité, vous comparez cette traduction avec une autre, et les ennuis commencent : ces traductions divergent, et pas seulement sur des points de détail. Pourquoi ?
Au début du 7e siècle, il n’existait pas de littérature arabe (1). Soudain au 8e siècle, apparût un texte, écrit dans une langue d’une grande beauté, qui n’avait aucun antécédent littéraire – fait unique dans l’histoire de la littérature mondiale. Les musulmans considèrent donc sa naissance comme un miracle : le Coran aurait été dicté au Prophète tel qu’il est conservé au ciel, de toute éternité, sur une « Table gardée. »
Pour les Juifs, sur le sommet fulgurant du Sinaï Moïse aurait reçu la Torah sur des tables écrites par le doigt de Dieu. Si le Coran avait été lui aussi écrit par Allah, il aurait été créé comme le reste de l’univers. Mais pour les musulmans, le texte du Coran n’a jamais été créé.
Comme Allah lui-même il est divin, c’est un Verbe incréé. (2)
C’est pourquoi le Coran affirme que « nul autre qu’Allah ne connaît l’interprétation du Coran. » (3) Parce qu’il est de nature divine, parce que c’est un attribut divin, il participe à l’infini d’Allah et on peut lui reconnaître une infinité de sens.
Traduire le Coran est donc chose impossible, ce serait dire dans une langue autre que la sienne ce que Dieu a dit dans sa propre langue – une langue aussi impénétrable qu’Allah lui-même. C’est pourquoi la traduction wahhabite, patronnée par l’Arabie Saoudite, s’intitule Le Saint Coran, traduction en langue française du sens de ses versets.
Une traduction ne peut que s’approcher du sens du Coran. En choisissant un seul sens, le traducteur trahit l’infinité de ses significations.
Dans la Postface de Naissance du Coran, je résume les travaux des chercheurs qui aboutissent à une tout autre conclusion. La langue du Coran serait issue de l’araméen, langue-soeur de l’hébreu, d’abord adoptée par des Arabes sédentarisés en Syrie et peu à peu transformée par eux au contact des parlers arabes qui étaient les leurs.
Si l’on veut, on peut dire que la langue du Coran est un araméen dialectisé par des Arabes à la fin du 7e siècle, dans le Croissant fertile.
Un arabe du 7e / 8e siècle est aussi éloigné de l’arabe moderne parlé dans les rues d’Alger ou de Rabat que le Roman de la Rose ou Rabelais sont éloignés du français parlé aujourd’hui à Paris. Oui, c’est de l’arabe (comme Rabelais est du français) mais bienheureux qui peut dire qu’il le comprend à livre ouvert.
Ses auteurs pouvaient être fiers d’eux, puisqu’ils avaient inventé une langue pour parler de Dieu et à Dieu, dont le Coran affirme qu’elle est « inimitable. » Et en effet, personne aujourd’hui ne la parle ni ne la comprend sans l’aide de spécialistes, qui souvent ne s’accordent pas sur le sens des mots et des tournures.
En Indonésie, au Pakistan, en Iran ou en Afrique sub-saharienne, les écoliers des madrasas apprennent par cœur et récitent un texte auquel ils ne comprennent rien. Même si leur langue natale était l’arabe, ils ne comprendraient pas car l’arabe qu’ils utilisent chaque jour est très éloigné de l’arabe coranique. Ils articulent et récitent des sons privés de sens, mais qui ont pour eux une valeur sacramentelle puisqu’ils sont divins en eux-mêmes.
Se posait alors à moi un problème : comment étudier un texte dont je ne comprends pas la langue originale ? J’ai donc comparé six traductions françaises avant d’en adopter finalement quatre autres, établies par des arabisants reconnus. Les 140 pages de Naissance du Coran comptent près de 400 citations du texte, j’en donne les références en indiquant (quand il y en a) les variations de traduction, et les justifications fournies par les traducteurs. Les versions de Masson, Berque, Blachère, Grosjean sont confrontées à chaque fois qu’elles divergent, travail complété quand c’est utile par les travaux de Bonnet-Eymard, Gallez, Hamidullah.
Vous n’aurez sans doute pas la patience de faire ce travail : il m’a permis d’approcher au plus près d’un texte devenu sacré, émanation divine qui met périodiquement le feu à la planète depuis 13 siècles.
NAISSANCE DU CORAN, aux origines de la violence
À paraître fin avril.
M.B., 10 avril 2014
(1) La « poésie préislamique » pose question.
(2) De même, pour les chrétiens Jésus est la Parole de Dieu incarnée.
(3) Coran 3, 7.