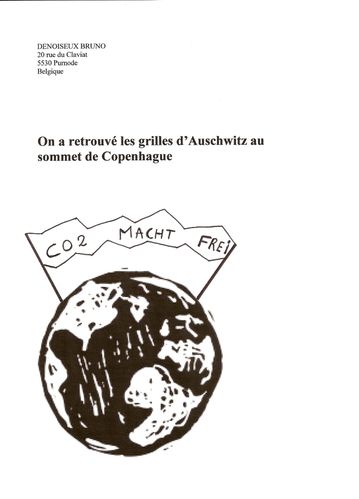Vers 1880, Nietzche écrivait : « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! » (1) À peu près au même moment, Karl Marx enseignait que les religions ont été créées par des sociétés d’oppression. Dans une société moderne (socialiste) Dieu disparaîtra, tout naturellement, tout simplement, comme la branche morte d’un arbre en pleine croissance.
Depuis, ces deux penseurs ont puissamment influencé la planète. Libérées de Dieu, les sociétés pouvaient enfin vivre leur vie.
Nous les avons crus : ils avaient raison.
Eh bien non, ils avaient tort. À la fin du 20ème siècle (2) Dieu, ou plutôt la religion, a fait un retour fracassant sur la scène mondiale. Aujourd’hui, il n’est plus un journal télévisé ou radio, un quotidien ou un périodique, qui ne titre sur la religion : elle est (re)devenue un acteur incontournable de la vie politique et sociale.
Loin d’effacer Dieu de la scène, la modernité l’a fait rentrer de manière fracassante. Le mot est juste, puisque Dieu est le moteur du fracas mondial actuel.
Regardons-y de plus près.
Des religions sans Dieu
Trois religions dominent le fracas mondial : le judaïsme, le christianisme et l’islam.
Traduisez le sionisme, l’Occident et le Moyen Orient.
Trois civilisations, trois cultures qui s’affrontent dans un chassé-croisé de violences sans fin.
Dans Naissance du Coran, j’ai montré que ces trois entités culturelles avaient une même origine, une même source, le messianisme. C’est parce qu’ils sont issus d’une même matrice messianique que Juifs, occidentaux et musulmans se haïssent et se combattent.
Pourtant, ces trois cultures religieuses n’ont-elles pas le même Dieu ?
Non. Depuis Jésus, le Dieu juif n’est pas le même que le Dieu chrétien. Et le Dieu du Coran, qui puise son identité dans le judéo-christianisme, n’est pas le même que celui des Juifs et des chrétiens.
Première constatation, qui rend illusoire le ‘’dialogue interreligieux’’. Impossible de dialoguer quand, sous le même mot ‘’Dieu’’, on met trois choses différentes.
Mais il y a plus grave : dans leur expression et leur mise en œuvre, chacune de ces religions s’affiche pratiquement comme une ‘’religion sans Dieu’’.
Le sionisme ne se réfère pas au Dieu de Moïse, mais à la saga des premiers conquérants de la Palestine, Josué et ses successeurs (cliquez). Dans le Coran, les islamistes choisissent les versets brûlants qui appellent au génocide des Juifs et des chrétiens, et qui contredisent radicalement la tradition judéo-chrétienne dont ce texte est issu.
Quant aux catholiques… Les papes ne s’engagent plus que sur la morale, sexuelle ou familiale. Dieu a disparu du discours officiel de l’Église catholique.
Telles qu’elles apparaissent sur la scène du monde, les trois religions monothéistes sont sans Dieu. Des partis politiques comme les autres, engagés dans des polémiques politico-morales.
Retour de Dieu, absence de Dieu
Ce que Jérusalem, Rome et La Mecque oublient, c’est que les sept ou huit milliards d’être humains de la planète ont tous, chevillée au corps, la même interrogation douloureuse : quel est le sens de ma vie, de nos vies ? Comment supporter la souffrance ? À part produire et consommer, qu’est-ce que je fais sur terre ? Et après cette vie fugitive, qu’y a-t-il ?
Ces questions de fond, l’immense majorité ne se les pose pas consciemment, ou même les rejette au nom de la mort de Dieu. Oubli trompeur, elles ressurgissent à la première catastrophe, à la première guerre, à chaque mort d’un être aimé.
Les religions n’y répondent plus, parce qu’elles ont oublié Dieu.
Dieu est revenu en force, mais pour opposer les humains.
Quel ‘’Dieu’’ ?
Chacun de nous est renvoyé à sa quête de sens individuelle. Chacun doit trouver, tant bien que mal, dans les placards poussiéreux de sa tradition religieuse d’origine, la trace d’un Dieu omniprésent, et omni-absent.
M.B., 6 novembre 2014
(1) Le Gai Savoir
(2) On peut dater ce virage autour de 19980.