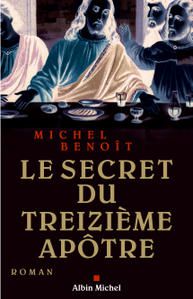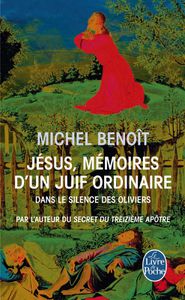La crise de l’Occident, dont nous sommes les témoins inquiets, est un sujet qui nous touche profondément, parce que nous sentons qu’elle concerne notre civilisation.
La plupart des historiens et sociologues la décrivent sous son aspect économique, démographique, environnemental, politique, moral ou social. Je voudrais avec vous porter sur cette crise un autre regard, afin d’en identifier – si c’est possible – la racine profonde.
Pour cela, nous allons définir rapidement quelques termes :
Civilisation : Une civilisation, c’est une identité culturelle, associée par chaque individu à une partie de l’humanité à laquelle il peut s’identifier. Cette partie de l’humanité est un groupe plus étendu que la tribu, la région ou la nation.
Référent : L’identification des peuples à une civilisation s’effectue à travers ce que la linguistique appelle des référents : un référent, c’est un outil verbal qui désigne un élément du réel. Ce réel, désigné par les mots à travers lesquels s’exprime une civilisation, il peut être du domaine des faits (par ex., la prise de la Bastille), mais aussi de l’imaginaire. C’est particulièrement vrai du fait religieux, dans lequel les sociologues identifient l’un des référents fondateurs de toute civilisation.
Crise : Une civilisation est en crise quand ses référents ne renvoient plus suffisamment au réel. Quand ses racines profondes sont devenues tellement lointaines, que les hautes branches ne peuvent plus y puiser leur sève.
Occident : Sa définition a d’abord été géographique, le bassin méditerranéen. Aujourd’hui et à cause de son histoire, l’Occident n’est plus une entité géographique, mais une réalité conceptuelle, référentielle.
I. LE PASSÉ (1) : ORIGINE DES RÉFÉRENTS FONDATEURS DE L’OCCIDENT
Il a fallu l’effondrement de deux civilisations successives (la Grèce, puis l’Empire Romain) pour que, sur leurs ruines, naisse l’Occident chrétien. Ne nous étonnons donc pas de le voir aujourd’hui à bout de souffle : « Nous autres civilisations, disait Valéry, nous savons que nous sommes mortelles ».
Tout commence avec Jules César. En 63 avant J.C., très jeune mais déjà animé d’une ambition dévorante, il devient Souverain Pontife de la religion romaine. Quelques années plus tard, il impose à Rome sa dictature : pour la première fois en Occident, les pouvoirs civil et militaire se trouvaient réunis, avec le pouvoir religieux, dans la main du même homme.
Cette conjonction des deux pouvoirs en un seul s’imposera à tout l’Occident, et jouera un rôle essentiel dans la naissance de ses référents.
Or il se trouve qu’au milieu du I° siècle, Rome traversait une grave crise d’identité. L’un des deux piliers du pouvoir, sa religion d’État, était agonisant, et l’Empire était envahi par des religions venues d’Orient – dont la mieux connue et sans doute la plus répandue était le culte solaire de Mithra. Ces religions étaient anciennes, mais vers l’an 60 une nouvelle venue va faire une entrée fracassante : le christianisme.
Comment s’est-il constitué ? En privilégiant deux directions :
1) Le messianisme, c’est-à-dire l’attente d’un Messie : Dans un premier temps, les fondateurs du christianisme identifient dans la personne de Jésus le Messie attendu par les juifs depuis l’effondrement du royaume de Salomon et l’exil à Babylone. Le messianisme sera le premier référent chrétien.
2) Le paganisme : Dans un 2° temps, ils prétendent que Dieu est devenu homme en Jésus, qu’il est ressuscité et monté aux cieux 72 heures après sa mort. Ils réintroduisent la nécessité du sacrifice sanglant pour obtenir le salut : le récent catéchisme de l’Église catholique réaffirme, contre les protestants, que la messe est bien un sacrifice. Tout cela ressemble furieusement au culte de Mithra. Ils créent une Église quasi-divine, détentrice des clefs du paradis, puis des sacrements, etc.
Ce faisant, ils tournent le dos à ce que Jésus avait enseigné, et lui attribuent des pratiques institutionnelles qu’un juif pieux comme lui ne pouvait ni instaurer, ni même imaginer.
Pourquoi cette greffe du paganisme sur la mémoire de Jésus a-t-elle a pris si facilement, et si rapidement ? Peut-être (je hasarde cette hypothèse) parce que le christianisme insiste sur la souffrance humaine, négligée par le mithraïsme. Un Dieu souffrant séduit plus facilement les foules souffrantes qu’un dieu solaire triomphant des ténèbres.
Ce christiano-paganisme messianique est légalisé par Constantin en 313. Effrayé par son succès, en 362 l’un de ses successeurs, Julien dit l’Apostat, tentera en vain une restauration du culte romain : le premier, il avait compris l’importance des référents dans la survie d’une civilisation. Nous savons qu’il était convaincu que l’Empire disparaîtrait, si sa religion traditionnelle ne retrouvait pas sa place incontestée.
Ce qu’avait prédit Julien se produisit peu après : l’Empire s’effondra. Sur ses ruines, l’Église chrétienne s’établit par un double mouvement : Entre 381 et 390, l’empereur Théodose décrète le christianisme religion officielle de l’Empire : de persécutés, les chrétiens deviennent persécuteurs. Persécution des religions anciennes, prise du pouvoir (privilèges politiques et sociaux, exemptions fiscales), puis élimination des rivaux religieux (sauf l’arianisme, dont nous reparlerons).
Parallèlement, consolidation du dogme de l’Incarnation (Nicée, 325) par celui de la Trinité (Chalcédoine, 451) : établissement d’une forteresse dogmatique à laquelle collaborent des esprits à la fois brillants et fanatiques d’Orient et d’Occident.
Pourtant les chrétiens, officialisés en 381 par l’édit de Théodose, se déchirent entre eux : sous les apparences dogmatiques, ce sont surtout des querelles de pouvoir. Les sectes chrétiennes pullulent, l’arianisme en tête qui refuse la divinité de Jésus.
En effet, les chrétiens à peine nés se sont opposés autour d’un point central : l’identité de Jésus de Nazareth. Une question lancinante ne cesse de se poser : si Jésus est Dieu, est-il toujours homme ? Et s’il reste homme, est-il également Dieu ? Comment ces deux existentiaux, inconciliables, peuvent-ils se trouver fusionnés en un seul individu ?
La réponse à cette question va susciter des affrontements, dont la violence nous étonne encore aujourd’hui. Je m’y arrête parce que les Empereurs – qui avaient réussi l’union, dans leur personne, du politique et du divin – ont pris une part active dans les luttes qui déchirent les chrétiens entre eux. C’est qu’ils savaient que la nouvelle civilisation, en train de naître, ne pourrait durer solidement que si elle était établie sur des référents indiscutables, indiscutés, universellement admis.
Le dogme de l’incarnation, la définition de la divinité du Christ jusque dans ses plus petits détails, va donc être la question centrale autour de laquelle se construiront, lentement, douloureusement, les référents de la civilisation occidentale.
Je vous passe les détails. Rappelons seulement que l’arianisme, né à la fin du II° siècle, et qui s’oppose à la transformation totale de Jésus en Dieu, a bien failli l’emporter. Sa condamnation finale au IV° siècle fournit au christianisme un socle idéologique suffisant pour s’imposer à tout l’Empire. Mais ce n’est qu’en 681 (III° concile de Constantinople), donc à la fin du VII° siècle, que les dernières conséquences de la divinisation du Christ seront tirées au clair.
Comme le messianisme, l’homme devenu Dieu – c’est-à-dire la divinisation de l’humain – va devenir un référent fondateur de l’Occident. Le siècle des Lumières n’est que la conséquence de la divinisation de l’humain.
II. LE PASSÉ (2) : EFFACEMENT DES RÉFÉRENTS
Le passage du VII° au VIII° siècle apparaît comme une période charnière.
1) On voit en effet Alcuin, théologien de Charlemagne, élaborer la notion de monarque de droit divin. Je remarque que cette doctrine politique n’a pu prendre naissance qu’à partir du moment où la divinisation de Jésus était acquise en Occident. De même que le Christ est l’image terrestre du Dieu invisible, de même l’Empereur devient l’expression visible, sur terre, de la volonté divine – et ceci, jusqu’à la Révolution française.
L’Occident a donc trouvé dans la divinité du Christ la justification du pouvoir impérial. Référent fondateur, le dogme de l’incarnation marque désormais de son emprise l’éthos – c’est-à-dire l’horizon éthique, culturel, social, esthétique – de la civilisation occidentale.
Jusque dans le moindre détail de leur vie quotidienne, les hommes et les femmes d’Occident seront formatés par ses ramifications.
2) C’est à ce tournant du VII° siècle, quand le dogme de l’incarnation n’est plus discuté en Occident, qu’un vigoureux mouvement d’origine arabe lance au monde un défi : une nouvelle religion, qui rejette explicitement l’incarnation de Dieu en Jésus, qui affirme l’unicité de Dieu, et accuse l’Occident d’avoir fabriqué, à côté du Dieu-très-Grand, un deuxième Dieu, incarné.
Quand on applique au Coran les méthodes de l’exégèse historico-critique, trois niveaux d’écriture apparaissent clairement dans le texte :
-a- Sa première source est juive : sous l’influence du rabbin de la diaspora juive de La Mecque, l’auteur, né arabe dans la tribu des Qoraysh, semble s’être discrètement converti au judaïsme tel qu’il était véhiculé à son époque : c’est-à-dire un judaïsme talmudique exalté, messianique, qui nous est bien connu par ailleurs.
-b- En même temps, il a rencontré des chrétiens hérétiques, rejetés par le christianisme impérial. Je les identifie aux nazôréens, l’une des tendances du judéo-christianisme primitif qui serait tombée dans l’oubli si Jésus n’avait pas été, de son vivant, affilié à cette secte juive d’origine baptiste. L’auteur du Coran s’est laissé séduire par le portrait nazôréen d’un Jésus exclusivement homme, et il effectue une synthèse de ces deux apports, juif talmudique et judéo-chrétien.
-c- Enfin, la troisième et dernière période d’écriture du Coran n’est rien d’autre que le carnet de route d’un chef de guerre arabe, le récit de ses démêlés politico-militaires avec ses voisins et de sa conquête du pouvoir par la violence.
On retrouve tout cela pêle-mêle, mélangé sans ordre dans les 114 sourates du Coran. L’auteur prétend répondre à la question qui avait si longtemps agité la chrétienté : qui est Jésus ? Et puisqu’il refuse sa divinité, quelles sont les voies d’accès au divin ? En rejetant ce qu’il appelle « la magie chrétienne », il crée le référent d’une nouvelle civilisation, l’islam, qui attirera à elle le quart de l’humanité.
L’islam coranique est donc la seule réforme radicale du christianisme qui ait réussi, là où tous les hérétiques de la Grande Église avaient successivement échoué. Il l’a fait, et continue de le faire, en s’opposant à une chrétienté considérée par lui comme infidèle à l’unicité de Dieu – c’est-à-dire païenne.
Mais revenons à l’Occident.
Pendant les siècles qui suivent, solidement campé sur une identité qui trouve sa source dans un référent désormais indiscuté – le dogme de l’incarnation défendu par l’Église -, l’Occident continue sa route. Et quand il étend sur la planète son modèle de civilisation, le christianisme triomphe avec lui. Tandis que l’islam s’efface – provisoirement.
Vont alors se produire en son sein trois secousses majeures. La première, la Réforme protestante, va entamer l’unité européenne cimentée autour de Rome. Mais Luther et Calvin n’ont pas remis en cause le dogme de l’incarnation, ils n’ont pas touché au référent fondateur de l’identité occidentale. Le moment le plus révolutionnaire de la Réforme apparaît comme celui où Luther traduit la Bible en langue allemande. A son insu peut-être, en mettant le texte sacré à la portée de tous, il a permis à l’Occident chrétien d’échapper au piège redoutable du fondamentalisme – du moins jusqu’à une époque récente.
La seconde secousse, c’est le mouvement des Lumières, le triomphe de la raison sur la foi considérée comme irrationnelle. Mais sa diffusion touche surtout les élites : au XIX° siècle, l’empreinte des Églises chrétiennes est encore très forte sur l’Occident. Grâce à la colonisation de la planète par les occidentaux, ces Églises deviennent des puissances mondiales.
Troisième secousse, la laïcité instaure difficilement la séparation des Églises et des États. Mais les référents des nouvelles nations européennes restent chrétiens. Les Églises, qui ont officiellement perdu leur pouvoir sur les sociétés, transfusent en elles l’essentiel de leurs valeurs et gardent ainsi leur emprise. Le code Napoléon, qui servira de modèle aux législations européennes, puise dans le Nouveau Testament une bonne partie de sa morale individuelle et sociale, ainsi que l’inspiration de ses lois.
Au tournant du XX° siècle, c’est la 1° crise moderniste : l’Église catholique, qui a encore une certaine vitalité intellectuelle, réagit en s’isolant dans sa forteresse dogmatique et en rejetant le monde moderne dans les ténèbres.
L’après-guerre connaît la 2° crise moderniste : on voit apparaître deux mouvements, l’un théologique et l’autre social, qui s’épaulent et remettent en cause la structure hiérarchique des Églises. Pourtant, en tant qu’institutions elles sont toujours partout présentes.
Souvenez-vous : dans presque toute l’Europe elles contrôlaient encore des partis politiques influents (les Démocrates Chrétiens), des syndicats, l’éducation, des mouvements de jeunes, des organismes caritatifs (devenus aujourd’hui ONG), elles tenaient des hôpitaux, des prisons. Chez nous le catholicisme inspirait – je cite en vrac – la littérature (Bernanos, Mauriac, etc.), la philosophie (Maritain, Bergson, Gabriel Marcel), la poésie (Claudel, Marie Noël, La Tour du Pin), la musique (Honegger, Poulenc), la peinture (Rouault, Cocteau), l’architecture (Le Corbusier).
Eh bien ! Le court temps d’une génération, la nôtre, tout cela s’est effondré. En un demi-siècle, le christianisme comme référent fondateur a disparu du champ de la civilisation occidentale et de sa créativité.
Ce déclin inexorable sera un temps masqué par l’expansion missionnaire du XIX° siècle, puis par la montée des fascismes au début du XX° : après la 2° guerre mondiale, il s’est transformé très rapidement en effondrement.
Commencé en 1962, le Concile de Vatican II a suscité de grands espoirs. Mais en refusant de toucher aux dogmes fondateurs, il s’est voulu délibérément comme un concile pastoral. Par ce terme qui définissait son absence d’ambition, l’Église du XX° siècle avouait qu’elle n’avait plus les moyens de bâtir, ou de rebâtir, les référents d’un Occident en crise.
Les avancées intellectuelles, sociales, morales et spirituelles au sens large se font désormais en-dehors d’elle : altermondialisme, condition de la femme, écologie, méditation, retour des religions « orientales », recherches sur l’identité de Jésus, etc.
Bref, le christianisme n’est plus aujourd’hui l’adolescent fougueux de ses débuts, en croissance irrésistible, faisant naître et entraînant derrière lui une civilisation conquérante. C’est un vieillard fatigué, ankylosé par les énormes calcifications idéologiques héritées du passé. Reliquat à la fois fastueux et pesant de ce passé, la chape dogmatique, faite d’éléments superposés au cours des siècles, empêche le christianisme de rester en contact avec la marche de l’humanité occidentale.
Conservatisme et perte de contact allant évidemment de pair.
Pour la première fois depuis ses origines, l’Occident se trouve en fait privé d’identité référentielle. L’Europe officialise ce fait en se refusant à intégrer, dans son projet de constitution de 2004, une référence à ses origines chrétiennes.
III. LE CHOC DES MESSIANISMES
Ce sont des sociologues américains (1) qui se sont penchés sur la notion d’effondrement des civilisations : tous reconnaissent, comme Christopher Dawson (2) , que « les grandes religions sont les fondements des grandes civilisations ». Mais dans leurs travaux, ils ne donnent guère au fait religieux la place centrale qui lui revient. Ils analysent les civilisations à coup de statistiques, et finissent par attribuer leur effondrement à des causes économiques, sociétales ou environnementales.
Dans la lecture que je vous ai proposée ici, au contraire, j’ai envisagé la naissance et la mort de la civilisation occidentale en suivant l’évolution de son référent principal, c’est-à-dire religieux. Je complète ainsi l’analyse trop factuelle des américains en intégrant les résultats de l’école française de sociologie, qui a étudié de près le déclin du catholicisme en France, et sa signification dans l’évolution des référents de notre pays.
Nous avons identifié la divinisation de l’humain comme référent fondateur de l’Occident. Pour comprendre la gravité du choc brutal de civilisations dont parlait Arnold Toynbee, il importe de revenir au premier référent, que j’ai laissé jusqu’ici de côté : la transformation de Jésus en Messie, le messianisme.
En fait, ce sont plusieurs formes de messianisme qui campent face à face, et cherchent à se détruire en l’emportant, chacune d’entre elle, sur les autres :
1) Le messianisme juif
Il a toujours été territorial. Pour les sionistes, le retour du Messie ne pourra s’accomplir que lorsque l’État juif se sera rétabli dans les frontières physiques du royaume mythique de David, le « Grand Israël » qui va du sud de la Syrie à la Jordanie actuelle – englobant bien sûr la Palestine dans sa totalité.
2) Le messianisme chrétien
Il n’a jamais été territorial, mais idéologique et politique. Le Messie reviendra quand toute la planète aura été baptisée sous la bannière du Christ-Roi.
3) Le messianisme fondamentaliste musulman
Le fondamentalisme, c’est la sacralisation d’un texte, considéré comme parole de Dieu lui-même et donc intouchable, devant être pris à la lettre.
Sa version musulmane est à la fois territoriale (la reconquête de la Palestine avec Jérusalem comme capitale politique) et idéologique/politique, quand toute la planète se prosternera en direction de La Mecque et de sa Ka’aba.
4) Pour mémoire, le messianisme communiste, accompagné du messianisme Nazi, qui ont lancé un bref éclat meurtrier avant de s’effondrer. Ici, c’est le prolétariat pour le communisme, ou le Peuple des Seigneurs pour le nazisme, qui étaient le Messie. Leur prise du pouvoir devait marquer le début de la fin de l’Histoire.
5) Enfin un nouveau venu, peut-être le plus dangereux : Le messianisme fondamentaliste américain
Né aux USA dans le renouveau évangélique des années 1970, il dispose là-bas d’une audience populaire considérable. Pour ces américains, le Messie tant attendu est enfin arrivé : c’est la morale, le mode de vie et de consommation, la démocratie et le capitalisme à l’américaine. Ici le Messie, c’est l’Amérique sûre de ses valeurs, et prête à les imposer à toute la planète, fut-ce par la force.
IV. L’AVENIR EN QUESTIONS
Pris en étau entre ces divers messianismes, chacun par nature dominateur et opposé aux autres, l’avenir d’un Occident désormais privé d’identité référentielle apparaît bien sombre.
Mais un mouvement se fait jour, très discrètement, au sein même du christianisme : j’y vois pour lui à la fois le plus grand danger, et le plus grand espoir.
En effet, depuis le milieu du XIX° siècle, des chercheurs (protestants, puis catholiques) se sont mis à étudier la Bible à l’aide d’un outil nouveau, la méthode historico-critique. Utilisant la linguistique, l’archéologie, l’épigraphie, l’Histoire et l’exégèse comparées, ces chercheurs situent les textes sacrés dans leurs époques et leurs milieux d’origine, dans leur culture de formation. Ils cherchent à dégager les faits, et les différents messages, de leurs contingences historiques. De plus en plus, ils se sont libérés, dans leur lecture, des lunettes contraignantes du dogme.
Ils redécouvrent ainsi la personne, et la personnalité du juif Jésus, la façon dont il a été transformé en Dieu, et les motifs de cette transformation. Ils parviennent à séparer ce qu’il a dit et fait, de ce qu’on lui a fait dire ou fait faire.
Leurs travaux, discrets et presque confidentiels, posent la vieille querelle de l’identité de Jésus en termes nouveaux. Non plus de façon polémique comme dans le passé, mais par l’étude sereine et objective des textes fondateurs chrétiens. Le dogme de l’incarnation, dans lequel nous avons identifié le référent principal de la civilisation occidentale, n’est plus remis en cause de l’extérieur, par ses ennemis, mais de l’intérieur, et par ses spécialistes les plus talentueux.
Certes, la redécouverte du visage et de l’enseignement authentiques du juif Jésus signent l’arrêt de mort d’institutions ecclésiales chrétiennes qui se sont constituées en les dénaturant. Mais elle met en lumière la personnalité fascinante et le message puissant d’un homme qui aurait pu faire naître un autre monde que le nôtre, s’il n’avait pas été trahi par les siens.
Cette démarche a-t-elle un avenir ? Pourra-t-elle offrir à une civilisation occidentale épuisée, vidée de sa substance, un nouveau souffle ? Pourra-t-elle proposer à nos jeunes d’autres perspectives, que celles des convulsions d’une société de consommation parvenue à des excès insupportables pour la planète ?
Et puisque le rejet d’un deuxième Dieu est l’élément moteur du Coran, le retour du christianisme à l’homme Jésus ne signerait-il pas la fin du Djihad, la réconciliation tant attendue entre chrétiens, musulmans et juifs ?
Oui, mais…
Quand on sait que les Églises chrétiennes, qui devraient être les premières à les assumer et à les diffuser, refusent absolument d’accepter les résultats de cette recherche, pour en tirer les conséquences.
Quand on voit qu’en Occident, depuis la fin du communisme et la remise en cause du capitalisme, la quête de nouveaux référents s’exprime en-dehors des institutions religieuses traditionnelles.
Quand on voit la France s’interroger sur son identité.
Quand on connaît enfin l’imbrication des ambitions politiques et des objectifs religieux…
On a tendance à perdre espoir.
Lorsque notre génération – la dernière à avoir connu une civilisation désormais agonisante –, lorsqu’elle ne sera plus là… Qui donc pourra transmettre à nos petits-enfants l’ambition d’un Occident, unifié autour de valeurs communes ?
M.B., Nice, le 13 janvier 2011
Cette conférence est une synthèse de plusieurs articles publiés dans ce blog (Entre autres, catégorie « Crise de l’Occident »)
(1) Arnold Toynbee, A Study of History , 1961 : « Les civilisations meurent de suicide, pas d’assassinat ». Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies, 1988. Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Jared Diamond, Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, 2005.
(2) Dynamics of World History, p. 128.