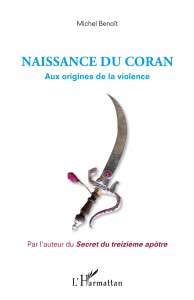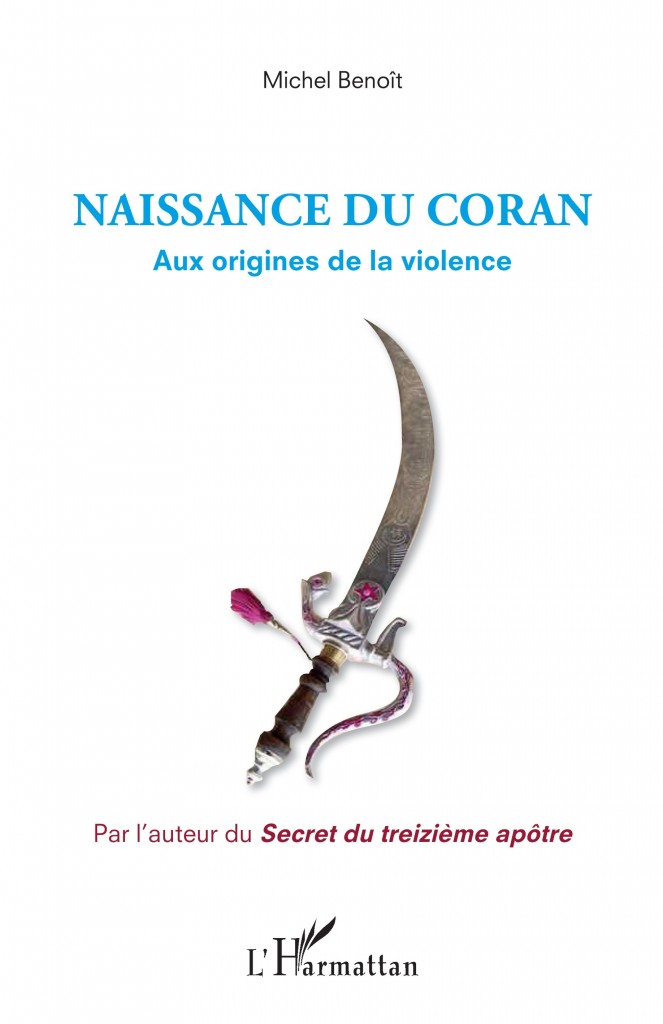Le Coran conduit-il les musulmans à la violence ?
La réponse politiquement correcte, vous la connaissez : « Non, le Coran comme l’islam ne sont que paix et tolérance. » Mais quand on le lit sans préjugés, la réalité est tout autre : oui, ce texte est intrinsèquement violent.
Né du Coran, l’islam est-il condamné à l’affrontement ?
Pendant 40 ans, j’ai travaillé en historien sur les origines du christianisme, ces deux ou trois générations de la fin du 1er siècle qui ont donné naissance à la civilisation occidentale. C’était naturel, puisque je suis né et j’ai grandi dans un monde chrétien. En revanche je ne suis pas un historien de l’islam, immense civilisation, multiple et complexe, qui n’est pas la mienne. Malgré le titre je ne vous parlerai donc pas de l’islam, mais uniquement de son texte fondateur, le Coran.
Pourquoi, après le christianisme, me suis-je intéressé au Coran ?
Au cours de mes travaux, j’avais découvert l’existence d’une secte juive peu connue dont Jésus aurait fait partie, les nazôréens. On ne sait rien d’eux à son époque, mais on sait que les tout premiers chrétiens ont d’abord été appelés nazôréens.
J’ai eu la surprise de voir réapparaître ces nazôréens dans le Coran, sous leur transcription arabe, nasârâ. Y aurait-il un lien historique entre les nazôréens du 1er siècle, et le Coran qui apparaît à la fin du 7e siècle ?
J’ai tiré ce fil, et toute la pelote est venue.
Mais comment procéder ? Les musulmans d’hier et d’aujourd’hui se heurtent à une barrière infranchissable : il leur est interdit d’étudier le Coran comme n’importe quel autre texte ancien, avec les méthodes de l’exégèse historico-critique qui ont fait leurs preuves. Pour eux, le Coran est descendu du ciel, fidèlement transmis au monde par le Prophète Muhammad. Chaque mot est la parole de Dieu lui-même. Matériellement, grammaticalement, le Coran est de nature divine, et on ne soumet pas Dieu à l’examen critique. Les rares érudits musulmans qui s’y sont risqués ont été assassinés, torturés ou exilés.
Alors, je me suis tourné vers quelques chercheurs de haut niveau, tous d’origine chrétienne, et donc libres d’appliquer au texte du Coran la méthode de critique historique qui a permis aux chrétiens de porter sur la Bible un regard nouveau. Depuis un siècle les travaux de ces chercheurs non-musulmans, inconnus du public, transforment complètement la compréhension du Coran et des débuts de l’islam.
Ces travaux, j’ai voulu les ramasser en peu de mots, de façon lisible malgré la complexité du sujet : c’est mon livre Naissance du Coran, aux origines de la violence.
Donner au public non spécialisé des clés de lecture, ouvrir des portes.
Ce petit livre permet de mieux comprendre quelques uns des drames qui ont secoué et secouent toujours la planète : pourquoi tant de violence au nom d’Allah, et pourquoi cet affrontement inexpiable entre l’Orient né du Coran, et l’Occident né du christianisme ?
Sans parler des Juifs, épine plantée au cœur des musulmans.
Mais revenons aux nazôréens du 1er siècle.
Ce qu’on sait d’eux, c’est qu’ils étaient judéo-chrétiens. C’est-à-dire qu’ils n’étaient plus Juifs, puisqu’ils considéraient que le Messie était venu en la personne de Jésus, mais ils n’étaient pas non plus chrétiens, puisqu’ils refusaient sa transformation en Dieu. Pendant les premiers temps du christianisme, ces judéo-chrétiens se sont opposés à la fois aux Juifs et aux chrétiens dont ils se séparaient, puis ils ont disparu, tous, au 3e siècle.
Tous… sauf les nazôréens. Saint Jérôme les a rencontrés à la fin du 4e siècle en Syrie, d’où il écrit à saint Augustin : « Ces gens veulent être à la fois Juifs et chrétiens, mais ils ne sont ni Juifs, ni chrétiens. »
Ni Juifs, ni chrétiens : c’est la définition des nazôréens. Opposés par nature à la fois aux Juifs dont ils ont rejeté la tradition, et aux chrétiens qu’ils refusent de suivre.
Au début du 7e siècle, la Syrie était presque entièrement chrétienne. Les nazôréens que saint Jérôme a rencontrés s’y étaient réfugiés pour fuir la persécution des Juifs et des chrétiens de Byzance. Ils s’étaient attachés à convertir à leur judéo-christianisme particulier des bédouins Arabes, sédentarisés dans la région côtière autour de Lattaquié.
Pendant ces six siècles de sommeil, ils s’étaient imprégnés du messianisme, une idéologie née dans le peuple juif exilé à Babylone en 587 avant J.C., et devenue flamboyante au tournant du 1er millénaire – c’est-à-dire à l’époque où vivait Jésus.
Dans mon livre, je résume la dérive de ce messianisme flamboyant dont on ne savait pas grand-chose, avant la découverte en 1947 des Manuscrits de la Mer Morte dans les falaises surplombant Qumrân, le haut-lieu des Esséniens. L’idéologie dont témoignent ces manuscrits, rédigés un peu avant et pendant le 1er siècle, est d’une extrême violence. Elle a profondément influencé les nazôréens – et à travers eux les Arabes qu’ils catéchisaient en Syrie, au début du 7e siècle.
Ce messianisme repose sur 3 piliers, qui n’ont pas changé jusqu’à aujourd’hui :
1- Utopique, il rêve du retour à un monde disparu, meilleur que celui-ci.
2- Apocalyptique, ce retour se fera par une guerre d’extermination, menée au nom de Dieu.
3- Messianique, il attend le retour d’un homme providentiel, le Messie sauveur.
La guerre, et la guerre totale, était pour eux le seul chemin offert à l’humanité pour qu’elle retrouve sa pureté, celle du paradis perdu par la faute d’Adam. Affamés de purification, ces messianistes divisaient l’humanité en deux : nous, les croyants qui ont reçu de Dieu la mission de dominer le monde, pour le purifier des autres, les incroyants.
Lesquels devront soit se convertir à notre vision du monde et aux lois qui en découlent, soit disparaître physiquement.
Voici un passage du Règlement de la guerre, texte essénien retrouvé à Qumrân : « L’extermination des nations impies est décidée. Sur les trompettes de la tuerie on écrira : ‘’Main puissante de Dieu dans le combat, pour faire tomber tous les infidèles ! ’’ Sur nos étendards on écrira ‘’Moment de Dieu, tuerie de Dieu’’, et après le combat on écrira ‘’Dieu est grand ! ’’ »
« Dieu est grand », en arabe Allah ou’akbar. C’est le cri de ralliement des musulmans, et c’est en le poussant que des fanatiques tuent ou se font tuer au nom d’Allah. Cette violence, elle leur vient des Esséniens, disparus en l’an 70 mais dont les écrits ont profondément influencé les nazôréens qui ont lancé, bien plus tard, des Arabes sur les pistes du désert.
Mais, me direz-vous, le Coran n’est pas né en Syrie ! Tout le monde sait qu’il a été révélé à un visionnaire arabe de La Mecque, le Prophète Muhammad qui n’a fait que répéter ce qu’il entendait du ciel ! Eh bien, c’est là que la recherche indépendante sur le Coran a cueilli ses premiers fruits. En montrant que tout ce qu’on dit et qu’on enseigne de Muhammad, de sa vie et de ses débuts à La Mecque, ne relève pas de l’Histoire mais de légendes construites un ou deux siècles après sa mort, par des historiographes au service des premiers califes de l’islam naissant, à Jérusalem d’abord puis à Damas et à Bagdad.
L’ambition de ces califes était politique. Pour transformer leurs conquêtes militaires en civilisation triomphante, ils avaient besoin – comme toute civilisation – d’un mythe fondateur. À partir d’un guerrier arabe, qui a bien existé mais dont on ne sait pas grand chose, ils ont donc forgé la personne du Prophète de l’islam, Muhammad.
Exactement comme les premières générations chrétiennes, pour fonder le christianisme, avaient forgé un Messie à partir d’un homme, Jésus.
Y a-t-il des éléments historiquement fiables dans la légende de Muhammad, construite par la Sirâ (Histoire officielle de l’islam), les Hadîths (paroles du Prophète) et la Sunna (ensemble de la tradition musulmane) ? Actuellement, il est impossible de répondre à cette question. Il faudra attendre que des chercheurs travaillent sur de nouvelles bases, et cela prendra du temps. Je m’en suis donc tenu strictement au texte du Coran tel qu’il nous est parvenu, laissant de côté l’ensemble des traditions séculaires à travers lesquelles les musulmans d’aujourd’hui se doivent de lire et de comprendre leur texte fondateur.
Le premier problème que j’ai rencontré était celui de la langue. Le Coran est écrit dans un arabe archaïque du 8e siècle, très différent de l’arabe parlé aujourd’hui. Une langue tellement étrange, si pleine de points de suspension et d’allusions obscures, que personne ne s’accorde sur le sens de nombreux passages. J’ai donc examiné six traductions françaises pour en choisir finalement quatre autres qui font autorité, et sont accompagnées d’un appareil critique important, à la fois linguistique et historico-littéraire. J’ai confronté l’une à l’autre chacune de ces traductions pour m’approcher du sens le plus vraisemblable, indiquant en note les différences d’interprétation qui justifient mes choix.
Ensuite, il y a la structure de ce texte, qui ressemble à un puzzle dont on aurait jeté les pièces au hasard sur une table. Voici ce qu’en disait le grand savant et philologue musulman Al-Kindi, cent ans après la mort du Prophète : « La conclusion est évidente pour quiconque a lu le Coran et vu de quelle façon, dans ce livre, les récits sont assemblés n’importe comment et entremêlés. Il est évident que plusieurs mains – et nombreuses – s’y sont mises et ont créé des incohérences, ajoutant ou enlevant ce qui leur plaisait ou leur déplaisait. »
« Plusieurs mains, et nombreuses » : comme toute œuvre littéraire, le Coran n’est pas né de rien, il n’est pas descendu du ciel. Il a une histoire, que seule l’exégèse historico-critique permet de comprendre.
Aucune logique donc dans ce texte, un fouillis inextricable. Tous ceux qui ont tenté d’y mettre de l’ordre ont dû y renoncer. Dans son état actuel le Coran est un peu comme un océan, on s’y plonge sans savoir d’où viennent, ni où vont les courants qui le traversent.
Soit on surnage, soit on s’y perd et on s’y noie. J’ai tenté de surnager.
Ce qui frappe, c’est que le Coran est d’une très grande beauté littéraire. D’où lui vient ce souffle, cette musicalité perceptibles même pour ceux qui ne le comprennent pas – c’est-à-dire la grande majorité des musulmans, pour qui cette langue si particulière est encore plus incompréhensible que ne l’était le latin d’Église pour les chrétiens ?
D’où vient la beauté du Coran ?
Il faut revenir à ses premières esquisses, c’est-à-dire au 7e siècle, en Syrie, dans ces communautés et ces monastères où des nazôréens catéchisaient des Arabes.
Pour leurs élèves, ils composaient des florilèges de textes tirés de la Bible, ou plutôt de l’une ou l’autre de ses versions talmudiques. Le Talmud est un immense commentaire de la Bible, écrit par des rabbins autour du 5e siècle après J.C. Ces textes, les nazôréens les psalmodiaient ou les chantaient devant les Arabes qu’ils voulaient convertir. « Coran » vient du verbe Quara’a, qui veut dire « réciter » : avant d’être écrit, le Coran a été récité et chanté dans des assemblées liturgiques, d’où sa beauté, sa musicalité entrainante.
La Bible du Coran n’est donc pas celle que nous connaissons, c’est la Bible du Talmud et de ses commentaires. De même que les évangiles que cite le Coran ne sont pas les nôtres : on les appelle apocryphes, ils sont remplis de légendes sur Jésus et sa mère, et ont été écartés quand l’Église a choisi de n’en retenir que quatre, jugés plus fidèles à la personne et à l’enseignement de Jésus.
Une Bible enjolivée par les rabbins du Talmud, des évangiles folkloriques et fantasmagoriques : ajoutez d’obscures légendes du désert, des allusions incompréhensibles à des divinités ou à des coutumes locales, et vous avez la moitié du Coran.
L’autre moitié, c’est tout un code de lois médiévales, mélangé à des appels véhéments au combat et à l’extermination, que j’appelle les versets brûlants.
Ces versets exigent des croyants qu’ils combattent contre les forces du Mal. Un combat messianique c’est-à-dire sans merci, sans rémission, qui durera tant qu’il y aura sur terre des infidèles qui refusent de se soumettre au Coran – et au pouvoir des califes.
Car pour les messianistes, religion et pouvoir n’ont jamais fait qu’un. Dans une communauté messianique, tout appartient à Dieu, corps, âmes et biens, le passé, le présent comme l’avenir. Notre laïcité, héritage du siècle des Lumières, est incompatible avec le Coran. Il ne distingue pas le matériel du spirituel, tout revient à Allah. Il veut accoucher d’un Homme Nouveau, dans une société totalement soumise à une Loi divine. Dans un monde purifié des démons de l’Occident chrétien. Boko Haram veut dire « enseignement interdit » – entendez : « enseignement occidental. »
Évidemment, pour la majorité des musulmans qui ne sont ni extrémistes, ni fanatiques, ces appels au meurtre de masse qui parcourent le Coran posent question : c’est le djihâd, le combat pour Dieu.
Pour rendre le Coran acceptable, on a donc cherché à distinguer deux sortes de djihâd : le petit djihâd, qui serait la violence du combat armé, et le Grand Djihâd qui serait le combat intérieur, celui de l’âme contre les tentations du démon. Une immense littérature a été écrite à ce sujet, dès le Moyen-âge, mais c’était oublier que le Coran puise ses sources dans le messianisme apocalyptique de ses origines. Pour que le monde retrouve la pureté du paradis perdu, une guerre d’extermination est nécessaire. C’est la seule façon de le purifier des forces du Mal incarnées par l’infidélité des Juifs et des chrétiens. Comme dans les écrits guerriers de Qumrân dont s’inspiraient les nazôréens, le djihad du Coran n’est pas un traité de spiritualité, c’est un chemin de violence et de sang.
Pour lancer les Moudjahidin au combat et à la mort, le Coran a dû reprendre une notion apparue dans le judaïsme au 2e siècle avant J.C., celle du martyre pour Dieu. Ceux qui se font tuer dans la guerre sainte menée pour la purification du monde, le djihâd, sont assurés d’aller au paradis. Et s’ils tuent ou massacrent, ils ne commettent pas un péché : « Quand tu lances ta flèche, dit le Coran, ce n’est pas toi qui lances la flèche, c’est Allah qui la lance. » Autrement dit, quand des Moudjahidin se font exploser en public, ils vont au paradis et ne sont pas responsables de la mort des innocents : « Ce n’est pas toi qui as tué, c’est Allah qui a tué. »
Quelques siècles plus tard, saint Bernard, Docteur de l’Église catholique, reprendra exactement les mêmes termes dans sa Règle aux Templiers, pour les appliquer aux combats des chevaliers du Christ lancés dans des croisades contres les musulmans impies. Vous voyez que les chrétiens n’ont pas de leçons à donner aux musulmans.
Car bien avant le Coran, l’idéologie messianique avait infesté le christianisme. On la trouve déjà dans des textes du Nouveau Testament comme l’Apocalypse dite de saint Jean ou l’Épître aux Hébreux. À partir de cette origine, le messianisme a évolué dans une direction commune à la chrétienté et au Coran, faisant couler des fleuves de sang sur la planète.
Rappelez-vous les trois piliers du cette idéologie : l’utopie, un monde nouveau à faire naître. L’apocalypse, ce monde ne naîtra qu’au prix d’une guerre d’extermination. Et le retour d’un homme providentiel, le Messie.
Rapidement, le Coran va abandonner le troisième pilier, l’attente d’un Messie personnel. Il va affirmer que le Messie est déjà venu, il est là, et c’est la Communauté des vrais croyants, l’Oumma – nom par lequel les musulmans se désignent. Et il va dire à ces croyants : « Vous êtes la meilleurs Oumma réalisée par Dieu pour les hommes », verset du Coran qui est devenu la devise de la Ligue Arabe basée au Caire.
Je retrace dans mon livre ce glissement, dans le Coran, de l’attente d’un Messie personnel vers l’affirmation que ce Messie est arrivé, et c’est une communauté impersonnelle mondiale, l’Oumma musulmane. D’ailleurs la profession de foi musulmane, « il n’y a de Dieu qu’Allah et Muhammad est le prophète d’Allah », ne mentionne plus l’attente d’aucun Messie.
Le drame, c’est que le christianisme a subi la même évolution. Théoriquement, les chrétiens attendent toujours le retour du Messie sauveur. Mais dans les faits, c’est l’Église qui est devenue pour eux le seul lieu du salut sur terre. Elle a repris à son compte et popularisé l’enseignement de saint Cyprien de Carthage (3e siècle) : Extra Ecclesiam nulla salus, hors de l’Église pas de salut.
Depuis lors et jusqu’à maintenant, sur la planète ce n’est pas au choc des civilisations que nous assistons : c’est au choc de deux messianismes. D’un côté « hors de l’Église pas de salut », et de l’autre « la meilleure Oumma réalisée par Dieu pour les hommes. »
Deux communautés-Messie qui ne pouvaient que s’affronter, qui s’affrontent toujours.
Les musulmans se trouvent donc dans une impasse mortelle, et nous avec eux. Leur immense majorité n’aspire qu’à la paix et ne se joint pas aux Moudjahidin fanatiques. Mais les uns comme les autres, les fanatiques comme les braves croyants pacifiques, tous invoquent le même texte fondateur devenu sacré, intangible et même intraduisible : le Coran.
On nous répète à longueur de médias la Pensée Politiquement Correcte : « Surtout, pas d’amalgame ! Ne confondez pas une poignée d’islamistes fanatiques avec les bons musulmans ! » Comme Tariq Ramadan, qui déclarait récemment : « Les islamistes prétendent que les musulmans sont dans la vérité, et tous les autres dans l’erreur. C’est une distorsion complète du message de l’islam. » (1)
De l’islam, peut-être. Du Coran, certainement pas.
Et quand il ajoute « il faut que les responsables musulmans condamnent fermement [cette idée] », c’est de l’hypocrisie. Car ces responsables ne peuvent pas condamner la violence des djihadistes, puisque que le texte du Coran est là, avec ces versets brûlants qui appellent les croyants à l’extermination des infidèles, et entretiennent depuis 13 siècles le feu sur la planète.
Comprenez bien : la violence du Coran ne réside pas d’abord dans ces versets brûlants. Si le Coran est violent, c’est avant tout parce qu’il sépare l’humanité en deux portions inconciliables, qui ne peuvent que s’affronter : ceux qui sont soumis à Allah-et-son-Prophète, et les autres – tous les autres.
Pendant 17 siècles, des chrétiens ont pratiqué exactement la même violence, à la fois idéologique et physique. Et pour la même raison, un messianisme entretenu par la lecture fondamentaliste de la Bible. Ils n’ont pu faire la paix en eux-mêmes et avec le reste de l’humanité (celle qui était « hors de l’Église »), puis entrer sans crainte dans la modernité, qu’à partir du jour où ils ont enfin accepté de lire et de comprendre leurs textes fondateurs à la lumière de l’exégèse historique et critique. C’est ce tournant idéologique qui leur a permis, non sans réticences, de faire un tri dans la Bible. Pour ne retenir que le meilleur du message des prophètes et de Jésus lui-même. Sans plus se sentir concernés par les appels à la violence qui parcourent la Bible et trouvent, comme le Coran, leur origine dans le messianisme flamboyant.
Jésus vivait au moment où ces textes ravageurs étaient mis par écrit et se diffusaient autour de lui. J’ai découvert qu’il était parfaitement au courant de l’idéologie messianique dont ses disciples étaient imprégnés, comme tous les Juifs d’alors. Cette idéologie, il l’a clairement et explicitement rejetée.
Jamais il n’a prétendu être le Messie attendu par les Juifs. Toujours, il s’est situé dans la continuation du mouvement prophétique initié par le prophète Élie.
J’ai mis en scène ce choix décisif dans mon dernier roman, Jésus, mémoires d’un Juif ordinaire. Ce n’est qu’après sa mort qu’il a été transformé en Messie, par les judéo-chrétiens de Jérusalem que côtoyaient les nazôréens. En franchissant ce pas, ils ont légué à la planète un lourd fardeau. Car faire du christianisme un mouvement messianique, c’était introduire dans la civilisation chrétienne en train de naître, puis plus tard dans le Coran, une utopie aux conséquences dramatiques : la nécessité, et la justification, des guerres d’extermination pour Dieu.
Cette idéologie judéo-chrétienne violente et conquérante, elle est l’utérus dans lequel le Coran a pris naissance et s’est développé.
Ensuite, le messianisme a poursuivi sur la planète sa carrière meurtrière. Au 20e siècle, il a inspiré deux idéologies totalitaires : le communisme, pour qui le Messie était la classe des travailleurs, qui l’emporterait sur la classe possédante en supprimant le capital et ceux qui en profitent. Et le nazisme, pour qui le Messie était le Herrenvolk, le peuple aryen des Seigneurs qui devait l’emporter en anéantissant les races inférieures.
Mais ce feu brûle toujours aujourd’hui. « L’Empire du Mal » : cette expression, écrite en toutes lettres dans les textes de Qumrân, vous l’avez entendue comme moi dans la bouche du Président des États-Unis. Les fondamentalistes américains (2), messianistes chrétiens, ont pris le pouvoir avec George W. Bush pour lancer, selon ses propres mots, une « croisade contre l’Empire du Mal. »
Depuis 2000 ans, rien n’a changé.
Les connaisseurs me reprocheront d’aller un peu vite aux conclusions : c’est possible, mais ils trouveront dans les notes de mon livre les références à mes sources, et les justifications de ce que j’affirme.
En fin de parcours, j’aborde enfin quelques questions brûlantes. La naissance de la première société totalitaire, à laquelle on assiste dans le Coran. Ce sont les califes qui ont esquissé les contours de la première police politique, surveillant une population interdite de penser et de s’exprimer. Cette réglementation qui asservit les croyants, hommes et femmes, ce sont bien les cours califales qui l’ont élaborée, en l’attribuant au Prophète.
J’ai tenté enfin de comprendre d’où venait l’antiféminisme agressif qui parcourt le Coran. Comment les califes ont-ils pu s’éloigner du judaïsme et du christianisme, au point d’introduire dans ce texte un mépris, on pourrait presque dire une haine des femmes, absente du judaïsme, du christianisme et des sociétés patriarcales de l’Antiquité ?
Il y a deux façons d’aborder un texte sacré : comme un monument qu’on ne visite qu’à genoux, face contre terre. Ou bien comme l’aboutissement d’une Histoire, et le commencement d’une autre.
C’est en apprenant à lire la Bible de façon exigeante, à la fois critique et respectueuse, que les chrétiens ont pu récemment s’apaiser, et accepter l’autre sans haine ni complexes.
Puissent les musulmans, dont la culture a pris naissance dans la même tradition, puissent-ils trouver, avec un regard nouveau porté sur leurs origines, le chemin de la paix.
D’abord en eux-mêmes, et ensuite avec le reste de l’humanité.
(Conférence donnée en Bourgogne, juin 2014)
P.S. : Je m’absente, et ne pourrai répondre à vos commentaires & messages qu’après le 29 juin
(1) Dans Le Point du 15 mai 2014.
(2) Voyez dans ce blog la catégorie « Les américains et la religion », et le mot-clé « messianisme »
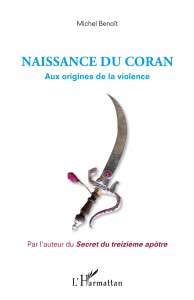
Commandez ce livre à votre libraire, ou sur le site http://www.harmattan.fr ou amazon.com